|
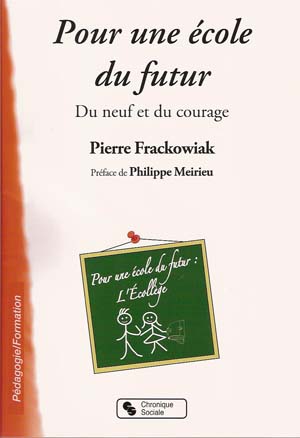 Le courage et la prudence Le courage et la prudence
Le courage n’est pas une vertu parmi d’autres. C’est la vertu sans laquelle il ne peut y en avoir aucune autre. Sans courage, la fidélité à ses idéaux se fait vite crispation sur ce qui fut important, voire révolutionnaire, mais qui est devenu un obstacle à toute invention et enkyste toute réflexion. Sans courage, la loyauté à son parti ou à son institution s’aplatît en « politique de la moindre vague », quand ce n’est pas en obéissance aveugle, plus ou moins teintée d’opportunisme carriériste. Sans courage, la lucidité affichée bascule dans le pessimisme désabusé, la critique engendre le fatalisme et les plus rationnels finissent toujours par invoquer le destin. Sans courage, l’exigence ne s’applique guère qu’aux autres et l’on s’exonère facilement de l’application des principes qu’on impose à ses adversaires. Sans courage, la solidarité se fait compassion et renonce à agir sur les causes de l’injustice, s’acharnant simplement à en faire disparaître les symptômes. Sans courage, l’inventivité s’englue dans les pansements provisoires et les revendications quantitatives. Sans courage, même les convictions les plus subversives s’enferment dans un conservatisme pieux. Sans courage, en réalité, nous n’avons aucune chance d’être à la hauteur de ceux dont nous nous revendiquons : Rousseau, Condorcet, Ferry ou Jean Zay, de loin le plus actuel et le plus courageux de tous.
L’absence de courage est donc profondément mortifère pour tous ceux et toutes celles qui militent pour un monde meilleur et une éducation à la hauteur des défis qui sont les nôtres aujourd’hui. L’absence de courage des partis de gauche sur les questions éducatives et scolaires est désespérante pour tous les citoyens. Pire, elle les précipitent dans les bras de ceux qui font passer leurs ambitions aventuristes pour du courage. Ces derniers apparaissent, en effet, comme les seuls à avoir des « idées neuves » ; ils peuvent, avec satisfaction et suffisance, stigmatiser le passéisme d’adversaires qui bégaient lamentablement. Disons le sans langue de bois : ce n’est ni l’intelligence, ni l’inventivité, ni même la cohérence des propositions de la droite en éducation qui font qu’elles accaparent le débat… c’est l’absence, en face, de propositions consistantes et hardies de la gauche !
Ainsi, la droite organise un tapage invraisemblable contre « la méthode globale » d’apprentissage de la lecture : où est la gauche ? Que fait-elle ? L’entend-on affirmer clairement que toute méthode de lecture doit être aussi un outil d’émancipation et tourner le dos aux conceptions effarantes de « l’enfant computeur » ? Non ! Tout juste bredouille-t-elle qu’elle-même avait, en son temps, exprimé des réticences contre la dite méthode ! La droite affiche sa volonté d’organiser le pilotage de l’institution scolaire « par les résultats » et – corollaire inévitable – de mettre en concurrence, les établissements et les maîtres. Que fait la gauche ? En profite-t-elle pour affirmer son attachement à un service public de qualité pour tous, pour rappeler que les résultats ne sont pas réductibles aux statistiques, aussi sophistiquées soient-elles, que le pilotage de l’école impose, à la fois, un véritable cahier des charges national et une relance des projets d’école et d’établissements ? Non ! Elle se contente de protester contre les suppressions de postes – c’est bien le moins qu’elle puisse faire ! – sans évoquer l’impératif républicain d’une redistribution de l’argent public en fonction des besoins sociaux ! La droite réduit la semaine scolaire en primaire, multiplie les prothèses extérieures à la classe pour satisfaire la demande de dispositifs individualisés, voire individuels. On attend de la gauche qu’elle reprenne le flambeau historique de la pédagogie et martèle que la réussite scolaire ne s’obtiendra pas en ajoutant sans cesse de nouvelles dérivations à la classe, mais en changeant la manière de faire la classe. Mais on attend en vain ! La droite surfe sur les inquiétudes des parents en matière de violence scolaire ; elle s’engage dans une politique sécuritariste, met en place des barrières autour de l’école et des sanctions dans l’école. La gauche pouvait, alors, rappeler fermement que c’est en restructurant l’école du dedans, en l’organisant comme espace construit pour apprendre ensemble, en travaillant en équipe, en créant des unités pédagogiques à taille humaine… qu’on fera reculer la violence scolaire. Mais, non ! La gauche, une fois de plus, n’est pas au rendez-vous !
C’est que notre système scolaire est enkysté dans des modalités de fonctionnement qui ont, jadis, constitué un progrès considérable, mais qui sont devenues un obstacle à son développement. Pour l’essentiel, ces modalités sont antérieures au grand mouvement de démocratisation de l’accès au secondaire qui a commencé avec la prolongation de la scolarité obligatoire à seize ans en 1959. C’est la classe, toujours en quête d’une improbable homogénéité, et le modèle transmissif, collectif et frontal, qui lui est associé. C’est la conception du travail scolaire dans les « disciplines nobles », selon laquelle on vient à l’école écouter le cours et l’on repart chez soi faire ses devoirs. C’est l’organisation en paliers successifs d’une année qui condamne à faire redoubler dans toutes les matières un élève qui est insuffisant dans l’une d’entre elles. C’est la notation sur 20 qui aboutit à reconstituer systématiquement la courbe de Gauss, avec un tiers de bons, un tiers de moyens et un tiers de faible. C’est l’orientation par l’échec vers l’enseignement professionnel qui condamne ce dernier à rester une voie d’exclusion. C’est l’organisation caporalisée de l’administration et le système de l’inspection individuelle qui discréditent toute injonction au travail collectif. C’est la gestion technocratique des flux d’élèves et des promotions des enseignants qui interdisent de mener à bien dans la durée de vrais projets avec des groupes à taille humaine. Ce sont des programmes conçus comme des catalogues qui bloquent toute véritable initiative pédagogique. C’est un emploi du temps en « tranche napolitaine » qui décourage toute tentative pour véritablement « différencier la pédagogie ». C’est l’anonymat au sein des établissements qui laisse se développer les tensions, quand ce n’est pas l’affrontement systématique. C’est la place ridicule donnée aux parents qui les amène à multiplier les pressions externes pour compenser l’absence de toute véritable écoute et concertation… Or, tous ces éléments ne sont jamais vraiment réinterrogés par les politiques – y compris de gauche – qui les considèrent comme des « vérités éternelles et immuables », gravées dans le marbre… et condamnent, tous partis confondus, la moindre réforme à n’être qu’un vague toilettage assorti de discussions sans fin sur les moyens.
Il est donc temps d’avoir du courage ! Et c’est au nom de sa solidarité profonde avec les valeurs de la gauche que Pierre Frackowiak appelle ici ses camarades à cesser de patauger et de bégayer, pour s’empoigner, enfin, avec les vraies questions. Il le fait en procédant à une analyse serrée des déclarations, programmes, comportements et réactions de ceux dont il partage les combats au quotidien depuis des années, avec une obstination exemplaire. Il le fait en confrontant tout cela à ce qu’il a vécu sur le terrain et avec les apports des multiples collectifs qui ont travaillé avec lui. Il le fait sans se livrer à d’inutiles imprécations ou procès d’intention. Mais il le fait fermement. Parce que la fermeté est le meilleur service à rendre à ses amis.
Pour autant, Pierre Frackowiak ne confond pas le courage et l’inconscience. Il a assez milité, depuis des années, pour connaître de près la résistance des êtres et des choses. Contrairement à l’universitaire qui s’exprime ici, il sait tempérer les ardeurs de sa rhétorique. Il sait aussi que, pour avoir la moindre chance de réussir, il faut être « prudent ».
Car le courage n’exclut pas la prudence, il l’exige. C’est vrai pour l’alpiniste ou le praticien d’un sport de combat. C’est vrai pour l’adolescent qui doit apprendre à prendre des risques sans se mettre en danger. C’est vrai pour le politique qui doit pouvoir être hardi et opérationnel à la fois… La prudence, cette phronesis dont parle Aristote, est en effet, tout simplement, le corollaire de la modestie : nous ne sommes pas tout-puissants, le monde existe avant nous, la contingence est là, quoi que nous en disions et malgré toutes nos dénégations.
Mais la contingence ne nous impose pas, pour autant, l’opportunisme ; elle ne nous contraint pas à renoncer à nos valeurs ; elle nous invite à dialoguer avec elle. Cette mise en dialectique de la contingence et des valeurs est, d’ailleurs, la meilleure définition de l’intelligence politique et, peut-être même, de l’intelligence tout court. Pas question, en effet, de perdre de vue ses principes pour pouvoir saisir le kaïros, l’occasion : tout au contraire ! Pas question, non plus, de relâcher son attention sur l’histoire et les histoires dans lesquelles nous sommes embarqués, si nous voulons avoir la moindre chance d’en être les acteurs. La prudence est « tension », comme le montre bien Bruno Latour. Etre prudent, c’est être comme l’animal aux aguets, en alerte, porté par sa volonté et, en même temps, en quête du moment et des moyens de la réaliser. Etre prudent, c’est être vigilant, en recherche, capable d’expérimenter raisonnablement et de mettre à l’épreuve ce que l’on croit et veut. Et Pierre Frackowiak est, à cet égard, infiniment prudent : personne n’est, comme lui, aux abois de ce qui se passe aujourd’hui dans notre société, chez les enseignants et les parents, chez les élèves comme au sein des collectivités territoriales. Personne n’est, comme lui, en position de vigie, à l’affût des signes qui permettent d’entendre ce qui se trame dans le corps social. Et, justement, il nous montre que ce corps social a besoin d’espérance. Il a besoin de perspectives claires et d’ambitions auxquelles s’adosser pour ne pas s’abîmer dans la dépression ou dans la répression.
Et nous voyons ainsi, grâce à lui, à quel point il est temps de saisir le kaïros : inquiets, découragés, caporalisés, acculés à la désobéissance, les enseignants de 2009 veulent une alternative à la politique actuelle. Ils sont en attente d’une parole forte. Ils n’ont pas besoin de nouveaux arrangements de façade ou de propositions de pacotille. Ils veulent pouvoir se saisir de véritables projets, ambitieux et consistants, quitte à les discuter, voire à s’affronter sur leur mise en application. Ils en ont assez d’être agressés, mais ils savent à quel point il est dérisoire d’être flattés. Ils ont simplement envie d’être respectés. Impliqués dans une action collective à la hauteur des exigences de la République et des difficultés de ce temps.
C’est ainsi que le livre de Pierre Frackowiak est, tout à la fois, un appel au courage et à la prudence. Courage de la pensée et prudence de l’action. Courage de l’action et prudence de la pensée. Puisse-t-il être entendu !
Philippe Meirieu
|
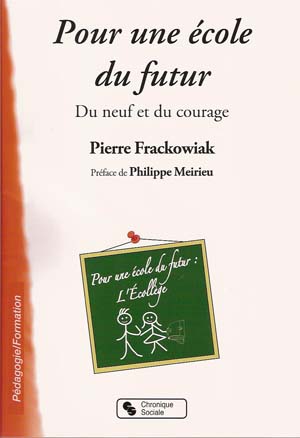 Le courage et la prudence
Le courage et la prudence