|
Je fais partie de ces élèves qui, très tôt, furent déclarés « nuls en langue » et qui, quarante-cinq ans après, n’ont toujours pas pu se dégager de ce qualificatif. Pourtant, j’étais plutôt studieux et j’apprenais très scrupuleusement les listes de vocabulaire qu’on me fournissait. Je potassais mes leçons de grammaire et écoutais attentivement en classe. Mais, dès que j’ouvrais la bouche, j’étais l’objet de la risée générale et, lors des devoirs écrits, je restais désespérément sec devant ma feuille. Je parvins, néanmoins, en jouant subtilement sur les moyennes, à accéder au baccalauréat et à l’obtenir dans de bonnes conditions. Ensuite, admis en classe préparatoire aux grandes écoles, je vécus, en langues vivantes, un véritable cauchemar : les listes de vocabulaire s’allongeaient à l’infini, les textes se complexifiaient, les versions et les thèmes se précipitaient… et je fus rapidement complètement noyé. On sous-estime beaucoup la panique qui peut s’emparer, alors, de quelqu’un : ce qui domine, à ce moment-là, ce n’est pas le sentiment d’étrangeté, ce n’est pas la peur de l’échec ou de l’humiliation, c’est la honte ! La honte de ne rien pouvoir saisir d’une langue que, pourtant, des millions d’hommes et de femmes, de tous niveaux, parlent « naturellement » sur la planète. La honte d’être exclu de ce qui devrait être « évident ». La honte de ne pas parvenir, en dépit de ses efforts, à trouver la moindre prise pour grimper sur une paroi désespérément lisse… Et nous sommes ainsi faits que nous reproduisons cette honte quand nous nous déplaçons à l’étranger. Bloqués par des apprentissages scolaires stériles, nous vivons la langue étrangère comme un univers d’où nous sommes condamnés à être exclus. On dira, à juste titre, que ces souvenirs sont très anciens et que nous n’en sommes plus là aujourd’hui. L’apprentissage des langues s’effectue maintenant dans un climat de confiance où la communication est centrale, où chacun peut s’engager et progresser, où les supports sont différenciés, où l’on équilibre subtilement le vocabulaire et la grammaire, les données techniques et l’approche culturelle, la mémorisation et la compréhension… Mais je m’interroge quand même en lisant l’ouvrage de Joëlle Cordesse : la révolution copernicienne, dans ce domaine comme tant d’autres, ne reste-t-elle pas à faire ? Ne vit-on pas encore, très largement, sur l’idée qu’il y a des élèves doués pour les langues et d’autres pas ? Ne considère-t-on pas, massivement, que la langue est un donné auquel il faut, d’abord, se soumettre ? Ne croit-on pas, plus ou moins, que la traduction est au cœur de toute démarche d’enseignement / apprentissage d’une langue étrangère ? Ne présuppose-t-on pas que l’appropriation d’une langue étrangère relève d’un exercice individuel et purement spéculatif dont les effets sont repérables de manière strictement quantifiable et en dehors de tout contexte ? En réalité, si l’enseignement des langues a beaucoup évolué, il reste assez conforme à la matrice de Comenius qui, dans La porte des langues, au XVIIème siècle, présuppose qu’on peut apprendre toutes les langues par une opération de translation, en « habillant » autrement les mêmes mots et les mêmes choses… Or, Joëlle Cordesse rompt avec ce modèle et nous propose, dans son livre, un tout autre paradigme : la langue à construire, avec d’autres, dans des situations d’invention / réinvention ; la langue à réélaborer par des sujets qui en saisissent (à tous les sens du terme) la portée symbolique. Joëlle Cordesse paraîtra à certains utopique : c’est tout l’inverse. Elle nous offre le vrai moyen d’apprendre à parler des langues vivantes… alors que nous continuons, trop souvent, à les enseigner comme des langues mortes. Ou pire encore : comme des langues enterrées vivantes ! Philippe Meirieu Professeur à l’université LUMIERE-LYON 2
|
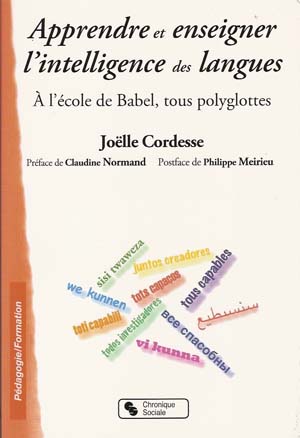 Langue vivante ou langue morte ?
Langue vivante ou langue morte ?