Quelle stratégie pour les militants pédagogiques aujourd’hui ? Conférence donnée par Philippe Meirieu le 15 mars 2008 dans le cadre de la rencontre organisée par les CEMEA à l’INRP à Lyon : « Éducation nouvelle, espoir d’une éducation renouvelée » - texte réécrit et complété par l’auteur. |
|---|
|
cliquer ici pour avoir le texte en PDF cliquer ici pour écouter la conférence
Je vais tenter de vous parler avec une sincérité dans le propos qui choquera sans doute certains, qui sera peut-être perçue par d’autres comme de la provocation… mais je crois que les militants pédagogiques que nous sommes sont assignés aujourd’hui à la lucidité et je voudrais, modestement, tenter de contribuer à la réflexion commune. Je le ferai à travers trois séries de remarques : la première évoquera « les militants déniaisés » que nous sommes devenus, la seconde dira la nécessité d’être « des militants recentrés », la troisième voudrait contribuer à ce que nous soyons « des militants déterminés ».
Contrairement à ce que pensent certains de nos amis, je ne suis pas de ceux qui pensent que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, celui de l’Education nationale par exemple. Je pense qu’en effet il y a une baisse du niveau et que, à force de nier l’évidence, on se discrédite et l’on se ridiculise. Cette baisse n’est pas globale, ni dans tous les domaines, mais elle existe dans des secteurs où elle a été mise particulièrement en évidence – l’orthographe, la grammaire – mais aussi pour ce qui est des repères historiques et culturels… Continuons à nier cette réalité et nous ne parviendrons pas à ce que les étudiants à l’université soient à même de manipuler correctement le français à l’écrit par exemple. Je voudrais souligner aussi que « Oui ! » il y a des établissements difficiles où même les militants pédagogiques que nous sommes ne mettraient pas systématiquement leurs enfants. Certains établissements sont de « vrais barils de nitroglycérine », dont on ne sait pas s’ils pourront subsister longtemps et s’il ne faudra pas y faire entrer bientôt des mercenaires pour pouvoir y enseigner. Je voudrais également dire que « oui ! », il y a eu des caricatures de l’Education nouvelle, caricatures qui nous ont particulièrement desservis. Il y a eu des amalgames entre certaines formes de « libertarisme » et l’Éducation nouvelle. Et je ne vise pas là particulièrement « Mai 68 » qui est un moment historique important d’une extraordinaire richesse et complexité que l’idéologie ambiante a tendance à confondre avec une simple convulsion de l’individualisme libertaire. L’Éducation nouvelle, contrairement aux lieux communs qui traînent un peu partout, ne s’est jamais reconnue dans Libres enfants de Summerhill, même si certains de ses militants ont été fascinés par cette expérience. De même, l’Éducation nouvelle n’est pas réductible à la non-directivité, apparue bien plus tard et si mal comprise : là où il n’y avait à trouver, selon l’expression de Daniel Hameline qu’une « hygiène mentale » capable de nous dégager de nos velléités d’emprise, on a cherché indûment un système d’enseignement et une théorie de la culture. De même, l’Éducation nouvelle n’a pas à endosser toutes les dérives d’une didactique technocratique et jargonneuse, qui n’a rien à voir avec ses principes, escamote la question du sujet comme celle de la relation pédagogique, oublie la dimension anthropologique et philosophique de la transmission. Il ne faut pas, par une sorte de solidarité inutile avec des « réformateurs didacticiens » - qui ne nous la rendront pas, d’ailleurs ! – défendre l’indéfendable ou s’excuser de ce que nous n’avons pas fait. Tout cela, évidemment, n’est pas très « pédagogiquement correct ». Pour autant, je ne suis pas de ceux qui disent que le passé est merveilleux et qu’il faut revenir au temps où les enfants obéissaient « au doigt et à l’œil » (ou « à la loi et à l’œil », selon un célèbre lapsus). Mais je pense que, dans les dix dernières années, nous sommes restés sur une position beaucoup trop défensive. Face à des retours en arrière revendiqués ou à des positions ouvertement réactionnaires, nous avons été acculés à défendre le statu quo… qui nous apparaissait, quand même, moins mauvais que ce qu’on nous proposait. Et, au bout du compte, nous avons même, parfois, été amenés à défendre l’état actuel du système comme si nous en étions responsables et comme si nos idéaux avaient été réalisés. Ainsi les militants pédagogiques, face aux attaques de ceux qui proposaient le retour aux « bonnes vieilles méthodes » pour lutter contre la baisse de niveau, se sont-ils mis parfois dans une posture de déni, en rupture avec leur « insurrection fondatrice » : « Mais non, tout va bien, le niveau n’est pas si mauvais, les jeunes ne posent pas de problèmes, les classes fonctionnent bien, etc. » La presse, les médias, par les configurations des débats qu’ils ont organisés – un partisan du retour au passé contre un « pédagogue » - nous ont placés en situation de défendre d’hypothétiques acquis sans pouvoir montrer le caractère de rupture de nos propositions. Au point que, pour l’opinion publique, nous sommes devenus les partisans de l’immobilisme contre ceux du mouvement ! Moi-même, alors que je me définissais comme un insurgé, j’ai ainsi été perçu souvent comme un défenseur du statu quo par ceux et celles qui, en réalité, ne voyaient en moi qu’un obstacle à leur désir de revenir en arrière. Il m’est alors arrivé d’être en situation de défendre l’indéfendable, de chercher désespérément des progrès dans un système dont je condamnais complètement le mode de fonctionnement, de prétendre que les choses n’allaient pas si mal, alors que toute mon énergie venait de mon désir de les transformer. J’ai joué à contre-emploi et je crois que cela n’a pas contribué à clarifier le débat et à encourager la mobilisation. En réalité, je crois que nous nous sommes laissés enfermer dans une mauvaise stratégie. Il faut avouer qu’il y a des classes qui ne fonctionnent pas, des collègues qui n’y arrivent pas, des situations éducatives désespérées, des enfants qui agissent de manière totalement intolérable et insupportable. Il faut l’assumer… au risque d’être provisoirement « récupérés » par nos adversaires. Il faut l’assumer jusqu’au bout, en montrant que l’Éducation nouvelle n’a jamais été véritablement aux commandes dans l’Éducation nationale : elle y a été présente, plus ou moins, plutôt dans le péri, le para et l’extrascolaire que dans le scolaire lui-même. Elle a pu instiller telle ou telle idée, mais elle n’a pas jamais été décisionnelle dans le système. Et, s’il y a eu, à certains moments, des avancées importantes que nous avons à saluer et dans lesquelles nous nous sommes reconnus, la plupart ont été démantelées : que reste-t-il du « tiers-temps pédagogique », des « 10% Fontanet », des « groupes de niveau ou de besoin », des Foyers socio-éducatifs, des classes à Projet artistique et culturel, des Travaux Personnels Encadrés, des Itinéraires De Découverte, etc. ? Certes, il y a bien des enclaves d’innovation ici ou là, des classes coopératives, des journaux scolaires, des projets citoyens, des actions avec les mouvements d’Éducation populaire et les parents… Mais, toujours, grâce à des collègues qui se sont impliqués comme militants, le plus souvent à contre-courant, sans aval de leur hiérarchie et en risquant en permanence un désaveu. Il est faux, absurde, malhonnête de prétendre que l’Éducation nouvelle a dirigé l’Éducation nationale pendant vingt ou trente ans et qu’elle est donc, en tant que telle, responsable de l’état actuel du système. En revanche, nous devons faire la clarté sur le contexte éducatif qui a beaucoup évolué et dont nous sommes tributaires. Il y a, bien sûr, la « montée des individualismes », un phénomène largement étudié et qui compromet la recherche du bien commun comme la construction de l’intérêt collectif. Il y a aussi l’avènement de ce que Bernard Stiegler nomme « le capitalisme pulsionnel » : un système d’organisation socio-économico-médiatique fondé sur la réalisation immédiate de la pulsion et, en particulier, de la pulsion d’achat. Ainsi susurre-t-on en permanence, à la fois aux enfants mais aussi aux adultes : « Satisfais tes caprices, ça fait marcher le commerce ». C’est un système qui exploite en permanence ce qu’il y a de plus infantile chez l’individu, qui érige le passage à l’acte en principe fondamental, substrat même du développement du commerce et de la société. Bernard Stiegler, dans son dernier ouvrage intitulé Prendre soin 1- de la jeunesse et des générations, parle même de « destruction radicale de l’appareil psychique juvénile ». Ce qui est en train de se passer, explique-t-il, avec la montée en puissance des systèmes de sur-stimulation, de sur-attention, de sur-information, de sur-investissement, détruit l’appareil psychique de l’enfant et rend impossible le travail éducatif. Car ce dernier – et les pédagogues le savent depuis longtemps – travaille précisément sur le sursis à la réalisation immédiate de la pulsion, pour permettre l’émergence du désir dans la temporalité ; il s’intéresse au sursis à l’acte, car il sait que c’est la condition de l’accès à la réflexion ; il rend possible le sursis à l’adhésion immédiate à toutes les injonctions idéologiques et médiatiques pour permettre la construction de l’esprit critique. La pédagogie, à travers l’Éducation nouvelle et malgré les maladresses de certaines de ses formulations, a toujours distingué le sujet conscient, capable de s’associer lucidement avec d’autres, de l’individu pulsionnel qui s’agrège à des groupes tyranniques. Et cette pédagogie est, plus que jamais d’actualité au moment où triomphent les industries de l’assujettissement des pulsions et de la coagulation fusionnelle. Ces industries engendrent, en effet, chez les enfants et adolescents d’aujourd’hui, des attitudes face auxquelles notre société prend peur. Nous avons joué aux apprentis sorciers et déclenché, chez eux, une explosion pulsionnelle qui met en danger la société elle-même. Leurs comportements nous inquiètent, nous effraient et nous semblent même, pour certains comme le happy slapping, basculer dans la barbarie. Or, face à cela, loin de nous retourner vers l’éducation et le patrimoine pédagogique, nous mobilisons la seule hypothèse qui nous paraît acceptable, la contention disciplinaire, chimique ou hypnotique. Nous avons joué avec le feu, produit des enfants qui sont effectivement beaucoup plus excités, beaucoup moins attentifs, souvent dans le passage à l’acte immédiat, assujettis à des groupes qui fonctionnent sur des principes tribaux, clivés entre nos préceptes éducatifs et nos modèles effectifs, entre nos leçons de morale et nos slogans publicitaires… et, face à ce que nous avons nous-mêmes produit, faute de vouloir réinterroger, réexaminer nos modes de fonctionnement, nous développons des systèmes de dépistage, de repérage et d’exclusion… bref, de contention de toutes sortes. Notre slogan : « liberté totale pour les marchands d’excitants, répression absolue pour les excités ». Nous sommes entrés, en effet, dans l’ère du « libéralisme autoritariste » décomplexé. L’autoritarisme n’est pas le contraire du libéralisme, mais son corollaire absolument nécessaire : dès lors que le libéralisme exacerbe les pulsions individuelles, il a besoin d’endiguer ces pulsions pour qu’elles ne fassent pas exploser le contenant social lui-même. Les libéraux du XIXe siècle l’avait parfaitement expliqué : le principe du système est que « les vices privés font les vertus publiques », il faut donc les encourager… tout en limitant les dangers qu’ils représentent par la religion, par exemple. Le libéralisme met en jeu des phénomènes qui menacent la cohérence sociale, et, pour préserver sa propre existence, il est contraint d’utiliser la contention. Prenons l’exemple de la montée dans tous les pays occidentaux du dépistage de l’hyperactivité. Nous sommes devant un phénomène terriblement simple : il y a de plus en plus d’enfants hyperactifs, turbulents, excités, que l’on détecte en faisant leur passer les fameux tests de Conners –particulièrement contestables aux plans psychologique et pédagogique – mais qui permettent de situer l’enfant dans la fameuse échelle américaine DMS4 et de leur proposer, non pas un nouvel environnement éducatif – faire du sport, du théâtre ou engager un suivi clinique… - mais pour devenir, dès l’âge de trois ans consommateurs de Ritaline ou de Concerta. Nous ne sommes pas là devant un phénomène anecdotique, mais devant un quelque chose d’extrêmement révélateur du fonctionnement de notre société. Nous choisissons de traiter l’hyperactivité – qui, effectivement, dynamite le système scolaire traditionnel – non par la recherche de nouveaux environnements éducatifs susceptibles de permettre aux enfants de changer de comportement, mais en développant un système de « camisole chimique ». Nous maintenons ainsi les enfants dans le cadre de « l’acceptable » sans avoir à interroger ni nos comportements éducatifs, ni le capitalisme pulsionnel lui-même. Et, il n’y a pas que l’hyperactivité… il y a tous les systèmes de dépistage de la délinquance, de repérage des déviants, de biologisation et de médicalisation de l’échec scolaire, de surveillance et d’exclusion de ceux et celles qui n’entrent pas dans la norme. Tout cela constitue un contexte général qui supporte et encourage tous les réflexes des partisans du « retour à l’ordre ». Certains d’entre eux sont mus par une réelle angoisse et de bonne foi. Il existe des parents qui ont peur devant le comportement de leurs enfants et se sentent complètement perdus. Il existe des enseignants, complètement désarmés face à ce qu’ils rencontrent dans leurs classes. Il existe des acteurs sociaux, dans tous les domaines, qui ne voient d’autre solution à la situation actuelle que la répression. L’autoritarisme se nourrit de ce phénomène de société, y compris pour enrôler un certain nombre de nos concitoyens qui ne sont a priori ni conservateurs, ni autoritaristes, mais qui, simplement, se disent que, si, dans les années 1950 où la société était très normée, il était nécessaire de développer des enclaves libertaires, aujourd’hui, quand la société est devenue hyper libertaire, il est nécessaire de développer une éducation très normée normées. Et les gens qui développent ce discours ne le font pas toujours dans une perspective réactionnaire, mais quelquefois dans une perspective de simple rétablissement de l’équilibre… Car il faut se souvenir que les intellectuels de la première partie du 20ème siècle considéraient l’école comme un lieu de la « pédagogie noire », très normée – collèges jésuites, internats « terribles »… et que Summerhill, par exemple, était une enclave libertaire qu’il fallait faire exister contre ce système hyper normatif. Aujourd’hui les mêmes intellectuels, parisiens pour la plupart, considèrent que, dans un système très « libéré », tant au plan familial que social, l’école doit fonctionner en instituant des enclaves de normalisation absolument indispensables. Il nous faut prendre conscience de ce mouvement de balancier qui relève de réflexes sociologiques explicables, mais ne constitue en rien une « théorie de l’éducation » acceptable. Impossible de confondre la pédagogie – en tant que réflexion rigoureuse sur les conditions d’émergence d’un sujet, à la fois intégré dans une histoire et libre de prendre ses distances avec elle – avec des réactions de peur collective, des emballements médiatiques et des calculs politiciens. Notre avenir ne peut dépendre de coups de boutoir d’un côté ou de l’autre. Pas plus que la société répressive du XIXe et du début du XXe siècles n’appelait « automatiquement » une éducation libertaire, la société libérale n’appelle une éducation répressive. Les sociétés, quelles qu’elles soient, appellent une véritable éducation cohérente avec leurs finalités. Et, pour ce qui nous concerne, nous avons besoin, je crois, d’une véritable éducation à la démocratie : une éducation de sujets capables de comprendre le monde dans lequel ils vivent, d’échapper à toutes les formes d’emprise et de s’associer pour chercher ensemble le bien commun.
Se recentrer sur quoi ? Je fais partie ceux qui pensent – je suis très minoritaire - qu’il faut se recentrer sur la spécificité de la pédagogie. Que met-on derrière ce terme ? Dans la Grèce antique, le pédagogue est un esclave qui accompagne l’enfant et lui fait découvrir l’école et le monde. Durkheim définit la pédagogie comme une « théorie pratique », un discours où la théorie et la pratique s’enveloppent réciproquement. Jean Houssaye définit, lui, la pédagogie comme la capacité à articuler des exigences de cohérence théorique et des exigences de mise en œuvre pratique. Il dit, à juste titre, que Kant ou même Rousseau ne sont pas des pédagogues : ils restent des théoriciens de l’éducation, qui ne se confrontent pas à des enfants concrets, qui n’éprouvent pas la résistance des êtres et des choses, qui ne pensent pas à partir de cette résistance et des questions qu’elle suscite. Néanmoins, cette définition me paraît encore insuffisante car elle recouvre finalement tous les discours tenus sur l’éducation par ceux et celles qui, d’une manière ou d’une autre, sont en position d’éduquer. C’est pourquoi je définis, pour ma part, la pédagogie, plus précisément, comme l’ensemble des travaux qui s’efforcent d’assumer et de dépasser la tension inhérente à toute véritable entreprise éducative entre le principe d’éducabilité et le principe de liberté : « Tout être humain doit et peut être éduqué » et « Nul ne peut éduquer quiconque contre son gré ».
C’est pourquoi je définis la pédagogie comme l’intégration de la question du sujet – de l’imprévisibilité, de la liberté, de la négativité - dans une action guidée par le principe d’éducabilité… C’est-à-dire comme la capacité à comprendre que le principe d’éducabilité n’est viable que s’il est associé à la reconnaissance de la liberté de l’autre : « Tout le monde peut apprendre et grandir, mais on ne peut contraindre personne à apprendre et grandir ». Cette double exigence nous donne un rôle très spécifique : créateurs de situations et de médiations pédagogiques. Elle distingue la pédagogie aussi bien du dressage que de la médecine. Quelle est la différence entre le modèle médical et le modèle pédagogique ? En caricaturant un peu, le modèle médical est caractérisé par la recherche du symptôme : lorsque le symptôme est identifié, le remède l’est aussi… le remède est, en quelque sorte, dans le symptôme comme la noix dans sa coquille. En quoi ce modèle est-il dangereux en éducation ? Parce qu’il présuppose, d’abord, un traitement individuel systématique des difficultés et, ensuite, parce qu’il pourrait conduire à penser qu’il suffirait d’avoir une bonne connaissance a priori de l’élève pour identifier la remédiation qui va lui apporter la solution… Or, le pédagogue agit autrement : ce n’est pas la connaissance de l’enfant qui permet d’agir sur lui, c’est l’action avec l’enfant qui permet de le connaître. C’est en proposant à l’enfant des activités que l’on découvre ce qu’il peut donner, ce qu’il peut faire, ce qu’il peut devenir… et que lui même, en s’emparant de ces découvertes parvient à « se faire œuvre de lui-même ». En matière scolaire, j’aurais beau analyser par tous les moyens un blocage sur une matière ou une acquisition, je ne trouverai pas, cachés dans l’origine du blocage, les moyens de le surmonter. Certes, la compréhension de cette origine pourra me fournir des indicateurs, orienter ma réflexion, mais, pour mettre en œuvre des activités stimulantes et efficaces, il faut que les maîtres fassent preuve de créativité : ils doivent inventer des situations et trouver des médiations, nourris par la connaissance de la tradition pédagogique. J’aurais beau savoir quelle est la raison singulière qui explique que tel élève est bloqué en mathématiques ou ne comprend pas la construction d’une description, j’aurais beau avoir connaissance des événements qui expliquent ces blocages… cela ne m’exonèrera pas de la nécessité d’imaginer des expériences nouvelles, de chercher des textes originaux, de créer des situations d’interaction qui vont lui permettre de se dépasser.
Je crois que, justement, nous sommes confrontés aujourd’hui à un retour du modèle « médical » en éducation au détriment du modèle pédagogique… et ce modèle médical nous submerge de toutes parts. À l’école, bien sûr, où l’on va faire du dépistage, mais aussi des évaluations en continu, chercher des systèmes de « remédiation » individuels et se contenter d’organiser une orientation « adaptée aux besoins » de chacun. Dans le travail social qui devient une sorte de « médecine sociale », impuissante en matière de prévention et se complaisant systématiquement dans la gestion bureaucratique des aides « adaptées ». Dans les loisirs où la demande devient de plus en plus individuelle en fonction des « profils », et même dans les dispositifs d’accompagnement scolaire, souvent obsédés par le traitement mécanique des difficultés quand il faudrait, au contraire, travailler sur le sens des apprentissages. À terme, c’est la mort de la pédagogie : il ne peut plus y avoir d’imagination, de création de situations et de médiations originales dès lors que l’on se trouve dans le couple « diagnostic-remédiation » indéfiniment fragmenté et multiplié. C’est pourquoi je considère que les militants pédagogiques doivent travailler obstinément sur l’articulation du « je » et du « nous », sur la manière d’instituer du collectif dans le social. Contre « l’individualisation individualiste » organisée par la machinerie technocratique et la coagulation des pulsions archaïques par laquelle répondent souvent les enfants et les adolescents, il nous faut créerdes structures, développer des projets, faire exister des groupes où l’intérêt collectif est mis en débat, où la distribution des places permet à chacun d’exister dans une juste distance à l’autre, où les cartes sont rebattues suffisamment pour empêcher que les individus ne s’enkystent dans des fonctions ou ne soient réifiés dans des « natures ». Le collectif, ainsi conçu, n’est pas spontané. C’est même la chose la plus difficile du monde à construire. Il faut toujours la remettre en chantier… Mais, c’est, à proprement parler, le combat « politique » par excellence, au sens le plus noble du terme. Dans cette perspective, et plutôt que de ressasser indéfiniment nos lieux communs défensifs, je crois que nous devons nous redonner l’autorisation d’inventer, de proposer, de créer des espaces, des lieux, des moments, des outils... Brefs, je crois que nous devons nous revendiquer délibérément pédagogues.
Et, pour exprimer, cette détermination, je fais sept propositions parmi bien d’autres…
|
 Je suis très touché de l’invitation qui m’a été faite de venir travailler avec vous. J’en suis très heureux car je ressens, de plus en plus, le besoin de faire vivre nos solidarités fondatrices. En ces temps où nous avons parfois le sentiment d’être seuls et de « ramer à contre courant », il est, plus que jamais, nécessaire de refaire vivre nos liens à la fois historiques et conjoncturels.
Je suis très touché de l’invitation qui m’a été faite de venir travailler avec vous. J’en suis très heureux car je ressens, de plus en plus, le besoin de faire vivre nos solidarités fondatrices. En ces temps où nous avons parfois le sentiment d’être seuls et de « ramer à contre courant », il est, plus que jamais, nécessaire de refaire vivre nos liens à la fois historiques et conjoncturels. Ainsi, deux grandes figures de la pédagogie apparaissent quasi simultanément au 18ème siècle : Itard, qui décide d’éduquer Victor de l’Aveyron, alors qu’il est considéré par tous comme un incurable, un débile définitif… et Pestalozzi qui décide qu’il d’éduquer les enfants de Stans alors qu’ils sont considérés comme socialement perdus, inéducables eux aussi, non pas pour des raisons biologiques mais pour des raisons sociales. Ils font le pari, l’un et l’autre, de réussir à éduquer les inéducables, de réussir à éduquer ceux dont personne ne veut. Et ils se donnent des moyens pour y parvenir… Qu’ils y parviennent bien ou non est une autre question : on peut discuter, par exemple, sur le fait qu’Itard ne soit pas vraiment parvenu à faire parler Victor : certains pensent qu’il s’y est mal pris, d’autres que Victor avait des lésions cérébrales irréversibles. Ceci est encore objet de débat… Mais on ne peut pas nier que ce qui a caractérisé l’entreprise d’Itard, comme celle de Pestalozzi, c’est le pari de l’éducabilité sur les « inéducables ».
Ainsi, deux grandes figures de la pédagogie apparaissent quasi simultanément au 18ème siècle : Itard, qui décide d’éduquer Victor de l’Aveyron, alors qu’il est considéré par tous comme un incurable, un débile définitif… et Pestalozzi qui décide qu’il d’éduquer les enfants de Stans alors qu’ils sont considérés comme socialement perdus, inéducables eux aussi, non pas pour des raisons biologiques mais pour des raisons sociales. Ils font le pari, l’un et l’autre, de réussir à éduquer les inéducables, de réussir à éduquer ceux dont personne ne veut. Et ils se donnent des moyens pour y parvenir… Qu’ils y parviennent bien ou non est une autre question : on peut discuter, par exemple, sur le fait qu’Itard ne soit pas vraiment parvenu à faire parler Victor : certains pensent qu’il s’y est mal pris, d’autres que Victor avait des lésions cérébrales irréversibles. Ceci est encore objet de débat… Mais on ne peut pas nier que ce qui a caractérisé l’entreprise d’Itard, comme celle de Pestalozzi, c’est le pari de l’éducabilité sur les « inéducables ».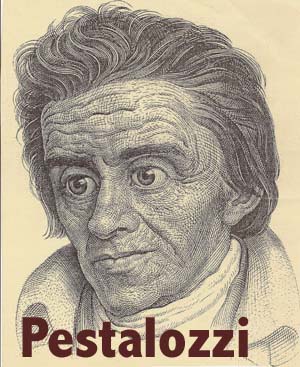 Cependant, on ne peut s’en tenir là pour définir la pédagogie. Car on voit bien que, très vite, le pari de l’éducabilité peut basculer dans la manipulation… Et la modernité, précisément, nous donne la possibilité de faire du pari de l’éducabilité un terrible instrument de manipulation. C’est la leçon de toutes les œuvres de science-fiction – 1984 d’Orwell ou Le meilleurs des mondes d’Huxley – que de nous montrer à quel point un projet éducatif peut devenir fou dès lors qu’il postule la malléabilité complète des personnes et qu’il décide d’utiliser tous les moyens pour y parvenir : après tout, dès lors que les individus sont éducables, pourquoi ne pas les mettre sous électrode pour qu’ils apprennent à lire ?
Cependant, on ne peut s’en tenir là pour définir la pédagogie. Car on voit bien que, très vite, le pari de l’éducabilité peut basculer dans la manipulation… Et la modernité, précisément, nous donne la possibilité de faire du pari de l’éducabilité un terrible instrument de manipulation. C’est la leçon de toutes les œuvres de science-fiction – 1984 d’Orwell ou Le meilleurs des mondes d’Huxley – que de nous montrer à quel point un projet éducatif peut devenir fou dès lors qu’il postule la malléabilité complète des personnes et qu’il décide d’utiliser tous les moyens pour y parvenir : après tout, dès lors que les individus sont éducables, pourquoi ne pas les mettre sous électrode pour qu’ils apprennent à lire ? Makarenko écrivait déjà, en 1923, à propos de la colonie et des délinquants qu’il accueille dans cette colonie : « J’estimais que la méthode de rééducation des délinquants devait avant tout avoir comme fondement l’ignorance complète du passé et, à plus forte raison, des délits passés ; mais appliquer ce principe en toute rigueur m’était moi-même très difficile (j’étais toujours tenté de savoir pourquoi un enfant nous était envoyé, et ce qu’il avait bien pu faire pour cela) ; en outre – c’était en 1922 – la logique habituelle de la pédagogie s’évertuait alors à singer celle de la médecine, et ratiociner en prenant l’air intelligent ; pour soigner la maladie, il faut d’abord la connaître. Ce genre de logique qui m’avait parfois séduit, tenait sous son charme tous mes collègues et le personnel de l’instruction publique ; la commission des mineurs délinquants nous envoyait les dossiers des pupilles avec le détail de leurs interrogatoires, confrontations… censés nous aider à mieux connaître la maladie et à agir sur elle. J’avais réussi à « ranger » à mon avis tous les éducateurs et dès 1922, j’ai prié la commission de ne plus m’envoyer aucun dossier. Nous cessâmes de nous intéresser de la façon la plus sincère aux fautes passées des colons et le résultat fut si heureux que les colons eux-mêmes les oubliaient rapidement. Je me réjouis vivement voyant s’effacer graduellement au sein de la colonie tout intérêt pour le passé et disparaître de notre vie les reflets de jours pour nous pleins d’opprobre, douloureux et exécrables. Sous ce rapport, nous atteignîmes l’idéal pédagogique jusqu’aux nouveaux colons qui se trouvaient gênés de raconter leurs exploits de délinquants, et qui devenaient fiers de ce qu’ils construisaient et non de ce passé dans lequel on les enfermait ».
Makarenko écrivait déjà, en 1923, à propos de la colonie et des délinquants qu’il accueille dans cette colonie : « J’estimais que la méthode de rééducation des délinquants devait avant tout avoir comme fondement l’ignorance complète du passé et, à plus forte raison, des délits passés ; mais appliquer ce principe en toute rigueur m’était moi-même très difficile (j’étais toujours tenté de savoir pourquoi un enfant nous était envoyé, et ce qu’il avait bien pu faire pour cela) ; en outre – c’était en 1922 – la logique habituelle de la pédagogie s’évertuait alors à singer celle de la médecine, et ratiociner en prenant l’air intelligent ; pour soigner la maladie, il faut d’abord la connaître. Ce genre de logique qui m’avait parfois séduit, tenait sous son charme tous mes collègues et le personnel de l’instruction publique ; la commission des mineurs délinquants nous envoyait les dossiers des pupilles avec le détail de leurs interrogatoires, confrontations… censés nous aider à mieux connaître la maladie et à agir sur elle. J’avais réussi à « ranger » à mon avis tous les éducateurs et dès 1922, j’ai prié la commission de ne plus m’envoyer aucun dossier. Nous cessâmes de nous intéresser de la façon la plus sincère aux fautes passées des colons et le résultat fut si heureux que les colons eux-mêmes les oubliaient rapidement. Je me réjouis vivement voyant s’effacer graduellement au sein de la colonie tout intérêt pour le passé et disparaître de notre vie les reflets de jours pour nous pleins d’opprobre, douloureux et exécrables. Sous ce rapport, nous atteignîmes l’idéal pédagogique jusqu’aux nouveaux colons qui se trouvaient gênés de raconter leurs exploits de délinquants, et qui devenaient fiers de ce qu’ils construisaient et non de ce passé dans lequel on les enfermait ». Voilà sept perspectives qui me laissent penser que, non seulement la pédagogie et l’Éducation populaire ne sont pas « ringardes », mais sont plus d’actualité que jamais. Voilà pourquoi nous sommes – et devons être – sur la brèche, mobilisés et déterminés, unis et outillés, intellectuellement et institutionnellement. Voilà pourquoi les militants pédagogiques doivent associer, selon la formule de Gramsci, « le pessimisme de la raison » – qui permet la lucidité – et « l’optimisme de la volonté » – qui reste notre devoir à l’égard de l’avenir.
Voilà sept perspectives qui me laissent penser que, non seulement la pédagogie et l’Éducation populaire ne sont pas « ringardes », mais sont plus d’actualité que jamais. Voilà pourquoi nous sommes – et devons être – sur la brèche, mobilisés et déterminés, unis et outillés, intellectuellement et institutionnellement. Voilà pourquoi les militants pédagogiques doivent associer, selon la formule de Gramsci, « le pessimisme de la raison » – qui permet la lucidité – et « l’optimisme de la volonté » – qui reste notre devoir à l’égard de l’avenir.