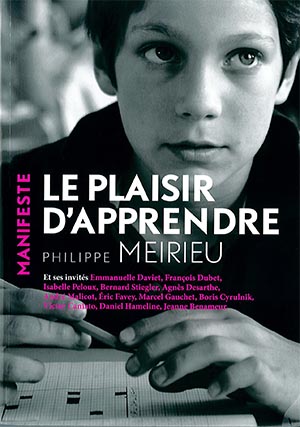 |
Philippe Meirieu et col., Le plaisir d'apprendre Paris, Autrement, 2014 Souvenez-vous du cancre de Prévert : « Il dit non au professeur, il est debout, on le questionne »… Comment enseigner à celui qui n’a pas envie d’apprendre ? Comment lui donner le goût du savoir ? Car la transmission est toujours fragile, souvent aléatoire ; l’apprentissage, lui, est parfois ingrat et semé d’embûches. Pour Philippe Meirieu, susciter le désir d’apprendre et faire accéder à la joie de comprendre, voilà l’enjeu essentiel de toute éducation et formation : il s’agit, ni plus ni moins, de replacer le plaisir au cœur des apprentissages, et cela tout au long de la vie. Pour ce manifeste, Philippe Meirieu a convié douze personnalités engagées et passionnées comme lui, afin de défendre à ses côtés le plaisir d’apprendre. « Ma conviction est faite et je n’en démordrai pas : dans la course effrénée que vivent nos enfants aujourd’hui, fascinés par la vie en trompe l’œil et en temps réel, la découverte du plaisir d’apprendre reste l’acte fondateur de toute éducation. »
|
PREMIER CHAPITRE
Le cancre et le ministre
Bien avant que les magazines ne titrent régulièrement sur le malaise enseignant, l’entrée dans le métier mettait déjà à rude épreuve les certitudes dogmatiques des bons élèves devenus professeurs. Je fus de ceux-là, découvrant à vingt ans que l’on pouvait se présenter devant une classe bardé de diplômes et de bonnes intentions, les savoirs au cœur et la fleur au fusil, pour ne rencontrer qu’une indifférence polie ou une hostilité larvée. On éprouve alors la terrible fragilité de toute entreprise de transmission : rien ne s’enseigne que l’élève ne désire apprendre, rien ne s’apprend qui ne requiert son engagement.
C’est là une de ces évidences discrètes qui reste pourtant prudemment à l’écart dans les conversations sérieuses sur l’école. Tout juste si, à un soupir ou un silence, dans une hésitation ou un lapsus, on discerne son ombre fugitive qui passe. Le temps d’un soupçon : « Et si la première entreprise du monde, le plus gros employeur de France, avec sa hiérarchie empesée, sa myriade d’instances et de commissions, ses milliers de textes réglementaires, pouvait être mise en échec parce qu’un gamin, tout à coup, est pris d’un fou rire ou de somnolence, se met à penser à autre chose ou a, subitement, envie d’aller aux toilettes ? »
Certes, toutes les organisations humaines sont à la merci de ces petits dérapages qui font capoter les programmations les plus savantes. Nulle technique ne peut nous débarrasser de l’aléatoire à jamais, et le grain de sable reste toujours embusqué quelque part dans un coin caché de la salle des machines la plus sophistiquée… Mais l’éducation est, à cet égard, un domaine particulièrement exposé. Sans doute est-elle même l’activité sociale où le sérieux des concepteurs est le plus systématiquement confronté à la désinvolture des usagers.
À un bout de la chaine, le ministre et son cabinet. Des académiciens et des académies. Des directeurs et des recteurs. Des intellectuels qui écrivent des manuels. Des chercheurs qui ont trouvé. Des conseils de savants qui donnent de savants conseils. Des lois de programmation et des programmes qui font la loi. Des inspecteurs au rapport qui produisent des tas de rapports d’inspection. Et des professeurs sagement alignés sur les étagères de l’administration, comme des Dalton touchés par la grâce, de l’agrégé hors classe au vacataire débutant.
Tout cela ferait une superbe pyramide, parfaitement ordonnée, au doigt du législateur et sous l’œil de Jules Ferry, s’il n’y avait, à l’autre bout de la chaine, une ébouriffante pagaille. Des gosses indisciplinés et des adolescents incontrôlables. Des petits d’hommes que l’on tente, vaille que vaille, d’asseoir dans une classe quand ils ne songent qu’à battre la campagne ou à courir les filles. Des êtres à qui l’on veut faire endosser le costume d’écolier alors qu’ils ne pensent qu’à se faire tatouer un manga sur le bras ou sur un dauphin sur la cheville. Des élèves qu’on s’évertue à faire lire et écrire quand ils n’aspirent qu’à cliquer et à twitter. Des enfants dont les parents galèrent parfois durement pour trouver un travail - ou, simplement, pour survivre - dans des « cités » où, précisément, la loi de la Cité et toutes ses institutions ont été destituées. Comment pourraient-ils encore croire qu’ « il faut travailler pour réussir » quand le dealer du voisinage gagne plus que le principal du collège et que les candidats des pires émissions de téléréalité [je préfère qu’on maintienne la référence à la téléréalité car toutes les enquêtes montrent leur impact majeur] sont les héros des seuls magazines qu’il trouve dans leur quartier ?
Pire encore, si c’est possible : même ceux et celles qui ont trouvé leur panoplie de bon élève au pied de leur berceau semblent parfois échapper à tout contrôle : leurs parents, pourtant, leur ont lu des histoires avant de s’endormir quand ils étaient petits, les ont amenés dans les théâtres subventionnés et les cinémas d’art et d’essai, les ont inscrits dans des clubs de sport pour qu’ils soient en bonne santé et ont garni leur bibliothèque de textes classiques et de revues scientifiques pour stimuler leur développement intellectuel ; ils leur ont bien expliqué pourquoi il fallait travailler à l’école et ont payé les répétiteurs nécessaires pour qu’ils apprennent leurs leçons correctement et rendent leurs devoir à temps. Foin de tout cela ! Ne voila-t-il pas que, contre toute attente, Armand ou Zoé se payent le luxe de ne pas aimer l’histoire ou de se faire confisquer le portable qu’ils écoutaient pendant le cours de mathématiques !
Serait-ce, alors, la faute du professeur de mathématiques ? Mais c’est que lui, non plus, n’en peut mais. L’homme est consciencieux et amoureux de la discipline qu’il enseigne. Il prépare ses cours minutieusement en suivant les ordres du programme et les conseils des didacticiens. Il s’astreint à accueillir ses élèves dans une classe où tout a été minutieusement préparé sur les bureaux et au tableau ; il donne des consignes claires et des exemples bien choisis ; il s’efforce d’être accessible sans cesser jamais d’être exigeant. Il incarne le savoir, la compétence et la bonne volonté tout à la fois. La culture et la République. Le passé à transmettre et l’avenir à préparer. Il est, à lui seul, un monument dont le ministre peut être fier et devant lequel, croit-t-on, chacun ne peut que s’incliner.
Et bien, non ! Aussi terrifiant que cela puisse paraître quand on réfléchit bien aux conséquences de la chose, rien ne garantit jamais qu’un élève sera attentif quand on le décidera, désirera apprendre ce qui lui est enseigné au moment où on le lui enseignera, mobilisera son intelligence et sa créativité sur ordre, ni même acceptera d’entrer dans une situation éducative que des adultes bienveillants auront soigneusement préparé pour lui.
Ainsi, entre Jules Ferry – ministre omnipotent à la tête d’une institution prestigieuse – et le cancre de Prévert – aussi banale et désuète aujourd’hui en soit l’image – c’est bien l’élève qui détient le pouvoir. C’est l’élève qui détient le pouvoir car nul ne peut – sauf à le mettre sous électrodes ou l’assujettir par l’hypnose – le contraindre à se mobiliser sur des savoirs, aussi importants et attractifs soient-ils. C’est l’élève qui détient le pouvoir car, si les savoirs lui préexistent, c’est lui qui, dans ses apprentissages et son développement, préexiste aux savoirs. C’est son attention qui est nécessaire, son engagement qui est requis, son travail qui, seul, peut le faire progresser. Toutes choses, précisément, que nul ne peut décider à sa place.
Est-ce à dire, alors, que l’enseignement est, décidément, un métier impossible et l’Éducation nationale une gigantesque farce ? Ce serait désespérer des humains et démissionner devant l’avenir. Or, notre responsabilité est engagée : nous ne pouvons pas renoncer à assurer la continuité du monde, la pérennité de la culture et l’exigence de la pensée. Mais nous ne pouvons pas, non plus, nous entêter jusqu’à l’absurde, nous crisper jusqu’à l’étouffement collectif sur le seul fonctionnement de la machine-école… au risque d’oublier que nul ne désire, n’apprend et ne grandit pour quiconque.
Il faut, pour entrer dans l’aventure éducative, intégrer son impouvoir radical sur la conscience et la volonté de l’autre. Mais en gardant néanmoins intacte la détermination de transmettre nos savoirs aux générations futures pour leur émancipation.
Car c’est là, au cœur de cette tension vive, que prend naissance la pédagogie. C’est là, face à cette contradiction que, jeune enseignant, je me mis à chercher comment susciter chez mes élèves le désir d’apprendre, comment leur permettre d’accéder à l’expérience décisive du comprendre. C’est là où je reviens sans cesse dès lors que je cherche encore, aujourd’hui, comment mobiliser sans manipuler, convaincre sans contraindre, instruire sans domestiquer.
Et, quand un jeune collègue m’ouvre la porte de sa classe ou de son atelier, quand j’entre dans une salle de cours ou un amphithéâtre, quand j’anime une réunion ou donne une conférence, je demeure habité par les mêmes questions : comment instituer là un rapport exigeant avec les savoirs ? Comment sortir de la docilité de l’habitude et de la facilité des stéréotypes ? Comment faire de la recherche de la précision, de la justesse et de la vérité la pierre de touche des échanges ? Comment, dans des institutions très largement dominées par la reproduction de la conformité au moindre coût, « faire événement », ne serait-ce qu’un instant ? Comment jouer là une scène qui se prolongera au-delà, pour chacune et pour chacun, une fois la cérémonie terminée et la porte refermée ? Comment faire émerger la joie d’apprendre et de penser, une joie galopante et contagieuse, une joie qui batte en brèche les fatalités, érode la résignation et invite au partage des savoirs ?
Je sais, bien sûr, l’ambition démesurée qui sous-tend ces questions. Je mesure la part de prétention qu’elles véhiculent : mais pour qui se prend-il celui-là à vouloir ainsi faire sortir des êtres de leur bienfaisante torpeur ou de leurs préoccupations immédiates ? Qu’on se rassure : la confrontation quotidienne avec l’exigence de transmission assigne à la modestie. Elle déjoue toute suffisance. Elle invite à l’invention besogneuse et obstinée. Elle n’exonère personne de l’inquiétude consubstantielle du projet d’enseigner. Avec l’âge et contre toute évidence, elle ne diminue point. Et, même si l’on a appris à faire bonne figure, c’est avec la même peur au ventre qu’on se livre à cette épreuve : qu’on entre dans une classe… ou qu’on soumette un ouvrage à un toujours hypothétique lecteur.