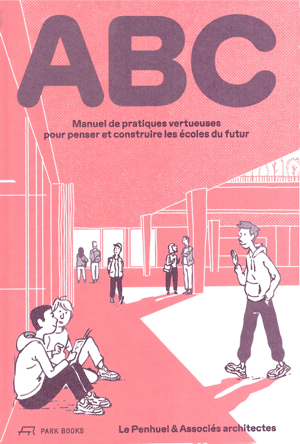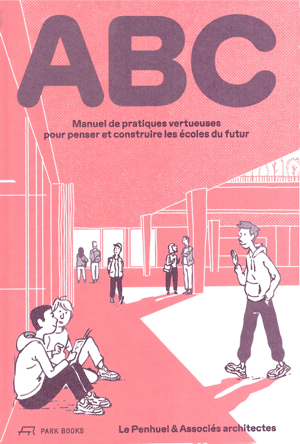
(Ré)inventer la "maison d'école"
Contrairement à ce que l’on croit souvent, ce n’est pas Jules Ferry mais François Guizot qui a dicté les principes d’organisation et de fonctionnement de notre École. Certes, Jules Ferry a fait voter, en 1882 et 1883, des lois fondatrices qui arriment notre École au projet républicain en instituant l’instruction obligatoire ainsi que la gratuité et la laïcité de l’école publique, mais c’est bien François Guizot – adversaire résolu de la République et du suffrage universel – qui avait auparavant posé les bases d’un système dont nous sommes aujourd’hui les héritiers. En effet, c’est dans la loi de 1832, sous la Monarchie de Juillet et alors que Guizot est ministre de l’Instruction publique, qu’on trouve, pour la première fois, l’obligation pour les communes de plus de 500 habitants d’ouvrir une école primaire – au moins pour les garçons – mais aussi la création d’une École Normale dans chaque département afin d’assurer la même formation à tous les instituteurs ainsi que la mise en place de corps d’inspection chargés de vérifier que les enseignants appliquent bien les instructions du « bulletin officiel » nouvellement créé.
Mieux encore, c’est Guizot qui va trancher la « querelle des modèles » et imposer à la France une « forme scolaire » qu’elle ne manquera pas d’exporter largement grâce à ses conquêtes coloniales. De quoi s’agit-il ? En ce début du 19ème siècle, l’école française n’a pas vraiment d’unité. Ainsi, alors que le préceptorat est assez largement répandu chez les aristocrates et les grands bourgeois, il subsiste encore, ici ou là pour les enfants du peuple, quelques reliquats du modèle moyenâgeux : des maîtres assurent, le plus souvent dans d’anciens locaux agricoles ou artisanaux, des sortes de permanence pour enseigner quelques savoirs élémentaires, en faisant venir les élèves chacun à leur tour près d’eux ; ici, pas vraiment de classe, seulement, parfois, quelques regroupements essentiellement constitués en fonction des « écolages » versés par les parents. Mais, chacun voit bien que ce modèle est condamné à très court terme tant il est injuste et inefficace à la fois. En revanche deux autres modèles sont apparus et ont le vent en poupe : le modèle mutuel et le modèle simultané.
On doit le modèle simultané à Jean-Baptiste de la Salle qui, à la fin du 17ème siècle a fondé les Frères des Écoles Chrétiennes. Soucieux de donner une instruction gratuite aux enfants qui ne pouvaient accéder aux écoles jésuites, alors très chères, il recruta des maîtres qui devaient consacrer leur vie à Dieu en instruisant les enfants pauvres. Avec eux, il ouvrit des écoles obéissant à trois principes fondamentaux et solidaires : l’instruction n’y était plus donnée en latin mais en français ; la leçon n’était plus faite individuellement mais devant une classe ; les classes devaient être constituées d’élèves capables de recevoir le même enseignement simultanément. Ainsi, commença-t-on à structurer les écoles en différentes unités d’enfants d’âges et de niveau relativement homogènes : ce furent, d’abord, des écoles de trois classes, puis, à la demande des maîtres qui souhaitaient toujours plus d’homogénéité en face d’eux, on s’efforça de faire coïncider les classes aux années de naissance.
Avec l’illusion rétrospective qui nous caractérise souvent, on pourrait croire que ce modèle s’est facilement imposé tant il nous apparaît aujourd’hui « aller de soi ». Il n’en est rien. Car, à côté du modèle simultané, un autre modèle était apparu : le modèle mutuel. L’Ecossais Andrew Bell et l’Anglais Joseph Lancaster l’avaient introduit à la fin du 18ème siècle. Bell expliquera en avoir trouvé l’idée lors d’une mission en Inde, Lancaster dira qu’il s’agit de la mise en œuvre à l’école de la doctrine de l’entraide promue par les Quakers. Dans les écoles mutuelles, les élèves sont regroupés en de vastes ensembles pouvant dépasser la centaine et organisés, pour chaque apprentissage (la lecture, l’écriture, l’arithmétique, la géographie, etc.), en huit « rangs », allant des élèves les plus avancés, quel que soit leur âge, aux débutants. Le maître n’enseigne qu’au premier rang et ce sont ces élèves du premier rang qui enseignent ensuite au second, les élèves du second qui enseignent au troisième, etc. Afin d’éviter le désordre, tout cela est très ritualisé et s’effectue dans d’immenses salles comportant un mobilier scolaire adapté (des petites et grandes estrades, de longues tables de tailles différentes), avec tout un matériel à disposition (ardoises, bouliers, panneaux d’affichage, signalétique sophistiquée, etc.) et des plans de circulation que les élèves doivent respecter.
Adapté en Suisse par Grégoire Girard et en France par Charles Démia, le modèle mutuel restera minoritaire mais sera soutenu par une partie significative des intellectuels de l’époque – des libertaires, des protestants, des militants « mutualistes » – qui y voient une manière d’introduire dès l’école une forme d’entraide réciproque susceptible de contribuer à la préparation d’une société plus solidaire. Mais Guizot, qui veut faire de l’École un des outils majeurs du « gouvernement des esprits », s’y opposera de toutes ses forces et imposera le modèle simultané, seul capable, à ses yeux, de contenir les velléités subversives du peuple en formant les petits Français à la nécessaire obéissance aux « maîtres » de toutes sortes.
Et Guizot va réussir au-delà de toute espérance. Au point que le modèle simultané est sans doute l’innovation pédagogique dont le succès a été, et reste encore, le plus éclatant. N’entend-on pas dire à chaque rentrée que l’essentiel est qu’il y ait « un enseignant devant chaque classe » ? Le monde entier, en effet, semble persuadé aujourd’hui qu’un dieu tout-puissant aurait dicté, un jour, à un Moïse scolaire, des tables de loi imposant que, « dorénavant et pour toute l’éternité, toute école sera organisée en groupes de vingt à quarante individus, du même âge et supposés du même niveau, alignés les uns derrière les autres, qui font la même chose en même temps sous l’autorité d’un enseignant. » Résultat : on n’organise pas nos écoles en fonction de ce que nos élèves doivent apprendre et de la manière dont ils peuvent l’apprendre ; on les contraint de s’inscrire dans une « forme » parallélépipédique, de s’y aligner en rangs, en rangées, en « classes » – le mot a été importé de la botanique et de la zoologie –, et l’on sacrifie ainsi bien des objectifs d’apprentissage, qu’ils relèvent des « savoirs fondamentaux » – lire, écrire, compter… mais aussi s’exprimer oralement et par son corps, chercher et enquêter, analyser et créer –, des « savoirs citoyens » – s’entraider, coopérer, débattre, décider ensemble du bien commun » – ou des grands enjeux culturels – découvrir et s’approprier les œuvres grâce auxquelles les humains, tout au long de leur histoire, sont parvenus à s’émanciper.
Oubliée la tradition des Compagnons du Moyen-Âge pour qui le travail de la main permettait de fixer l’attention, de dialoguer avec la matière qui résiste afin d’en comprendre les lois et de se dépasser jusqu’à l’accomplissement d’un chef d’œuvre… alors que tant d’élèves aujourd’hui peinent à intérioriser l’exigence de précision, de justesse et de vérité. Oubliées les vertus de l’entraide et de l’échange des savoirs promus par l’école mutuelle… alors que la recherche a mis en évidence ses immenses bénéfices cognitifs et socio-affectifs, aussi bien – et parfois même plus – pour celui qui aide que pour celui qui est aidé. Oublié l’extraordinaire privilège que constituait, pour les enfants africains, la possibilité d’aller deviser librement avec les anciens sous l’arbre à palabres… alors que nous savons maintenant l’importance de la transmission intergénérationnelle dont la fonction est, tout à la fois, apaisante et structurante. Oubliée le rituel du « vol des connaissances » que pratiquaient jadis les habitants du Népal en plaçant des gardiens effrayants autour des assemblées d’adultes pour faire mine d’effrayer les enfants mais pour leur donner envie, en réalité, d’accéder à des savoirs cachés… alors que nous voyons autour de nous à quel point le trop plein et l’accessibilité immédiate tuent le désir d’apprendre. Oubliées les classes de plein air, au Bhoutan et ailleurs, où les enfants délimitaient eux-mêmes leur espace de travail, construisaient leur bureau et cherchaient dans la nature les matériaux nécessaires à leur travail… alors que tant d’enfants aujourd’hui ignorent tout du monde naturel et sont tellement prisonniers de la virtualité qu’ils imaginent volontiers que c’est en criant sur les tomates qu’on les fait pousser plus vite !
Alors, bien sûr, il n’est pas question de revenir à ces modèles anciens articulés à des contextes sociétaux et culturels spécifiques, mais pourquoi en ignorer les leçons et rester figés dans une forme scolaire parallélépipédique elle-même imposée à un moment donné de notre histoire et, de toute évidence, largement obsolète aujourd’hui ? Les pédagogues, d’ailleurs, n’ont cessé d’en dénoncer le caractère arbitraire. Ainsi, déjà Pestalozzi, appelé auprès des orphelins abandonnés de Stans en 1792, renonça-t-il à organiser son enseignement en classes : sur une gravure de l’époque, on le voit discuter avec trois jeunes filles d’âges différents d’une planche d’architecture, tandis qu’à ses pieds une élève enseigne la lecture à de plus petits qu’elle et qu’à côté des enfants lisent pendant que d’autres jouent. Nul rang ici : « à quoi bon assujettir les corps, dit Pestalozzi, quand, de toutes façons, les esprits vagabonderont ? » Il vaut mieux distribuer des tâches qui mobilisent les élèves plutôt que de les assigner à une obéissance formelle… Et, en 1921, le pédagogue genevois Edouard Claparède, écrira, dans la mouvance de l’Éducation nouvelle née après la boucherie de la Première Guerre mondiale avec la volonté de préparer par l’éducation un monde de paix, un ouvrage décisif dont nous n’avons toujours pas tiré les leçons, L’École sur mesure. Il y affirme : « Lorsqu’un tailleur fait un vêtement, il l’ajuste à la taille de son client et, si celui-ci est gros ou petit, il ne lui impose pas un costume trop étroit sous prétexte que c’est la largeur correspondant en principe à sa hauteur. Au contraire, l’école habille, chausse, coiffe tous les esprits de la même façon. Elle n’a que du tout-fait et ses rayons ne contiennent pas le moindre choix. Pourquoi n’a-t-on pas pour l’esprit les égards dont on entoure le corps, la tête, les pieds ? »… Pour autant, Claparède ne rêvait pas de mettre chaque élève devant une machine qui lui proposerait, tout au long de ses études, un enseignement strictement individualisé, parfaitement adapté à son « profil personnel » et lui permettant de réussir à coup sûr. Car il savait que l’école n’est pas seulement faite pour « apprendre » mais pour « apprendre ensemble », les uns avec les autres et les uns des autres. C’est avec ce principe, d’ailleurs, que Célestin et Élise Freinet entreprirent de construire leur école à Vence en 1934 : sur un terrain boisé pour permettre aux enfants d’être en permanence au contact de la nature, ils construisirent une maison en respectant le dénivelé jusqu’à faire des marches d’escalier irrégulières « de manière à ce que l'enfant les monte non machinalement, mais en conscience ». On trouve là un théâtre de plein air, une piscine, un potager et un verger, mais aussi une terrasse solarium et des salles de travail de tailles et de formes différentes : un atelier pour l’imprimerie, un pour le modelage et un autre pour le dessin, des classes modulables où les enfants peuvent faire des « petites conférences », regarder des films, réaliser des expériences scientifiques ou bien travailler individuellement, un espace circulaire pour « le conseil », la « table ronde », où l’on n’entre qu’en ayant déposé sa « lance » – son agressivité et sa violence – à l’entrée afin de débattre sereinement du bien commun. La cantine, elle, ouvre sur la cuisine où les enfants sont mis à contribution comme pour la décoration et l’entretien de l’école qui devient ainsi complètement « leur maison ».
Mais, quoique souvent cités, les pédagogues sont finalement peu écoutés. Et l’école de Vence restera, avec les écoles installées par Le Corbusier au dernier étage de ses « cités radieuses », d’heureuses exceptions… tandis que fleuriront partout en France les « établissements Pailleron ». Certes, « l’explosion scolaire » due au boom démographique des années 1950 a contraint l’État à construire vite et à l’économie… et il n’est pas certain que les architectes d’alors aient eu beaucoup de marges de manœuvre. Fort heureusement, nous n’en sommes plus là et, si la dévolution des bâtiments scolaires aux collectivités territoriales a engendré des inégalités qu’il faudra absolument réduire, elle a permis néanmoins de libérer l’initiative et de renverser radicalement l’équation : on demande un peu moins aux élèves et à leurs professeurs de s’adapter à une forme scolaire normalisée et l’on s’efforce de penser un peu plus la « maison d’école » pour qu’elle permette d’y vivre et d’y apprendre le mieux possible.
Heureux renversement dont le présent ouvrage témoigne remarquablement. On y parle, en effet, d’« espaces différenciés », de « classes ateliers » mais aussi de « rues ouvertes », de « bibliothèques en libre accès » et de « terrains de jeux ». On y voit apparaître des « rotondes », des « alcôves », des « hameaux » et des « parvis ». On y « ouvre des brèches » et on y crée des « coins ». On « augmente la classe » et on « socialise le couloir ». On « décloisonne les espaces » et on crée des « continuités entre l’intérieur et l’extérieur ». On repense les ouvertures pour que l’école ne soit ni totalement « transparente » ni complètement « aveugle », mais qu’elle soit, tout à la fois, ouverte sur le monde et centrée sur le travail scolaire… Car les propositions architecturales qui sont faites ici ne relèvent pas de caprices de concepteurs ingénieux voulant absolument laisser leurs marques, elles sont pensées, conçues et mises en œuvre pour favoriser le projet même de notre École : apprendre à penser et à faire société, acquérir des connaissances et grandir en humanité.
C’est que les architectes qui s’expriment ici savent que « les pierres parlent » et que la structure et l’aménagement d’un lieu déterminent largement ce qui s’y passe. L’enfant ne se comporte pas de la même manière dans sa chambre et dans un théâtre, dans un train et dans un stade, dans une bibliothèque et dans une boîte de nuit. C’est pourquoi il est fondamental qu’il entre dans une école où il se sait accueilli et en sécurité, où les murs eux-mêmes témoignent de l’importance de cette culture qu’on cherche à lui faire aimer, où les rangements incarnent le souci de précision qu’on exige de lui dans ses travaux écrits, où il peut parler sereinement avec ses pairs dans des espaces dédiés, voir ce qui se passe dans la cuisine et aller aux toilettes sans se sentir humilié. Il est essentiel que l’école tout entière, dans tous ses espaces et ses moindres détails, témoigne des exigences qu’elle cherche à transmettre. Faute de quoi les élèves ne l’habiteront pas et continueront à se dire que « la vraie vie est ailleurs ».
Philippe Meirieu
|