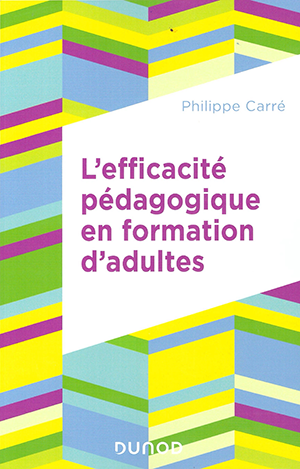Quoique probablement aussi ancienne que l’homo sapiens, la formation des adultes a longtemps peiné à s’inscrire dans les projets politiques et à être reconnue par les institutions. C’est que, sans doute, les humains ont toujours privilégié les temps de production, absolument nécessaires à leur survie immédiate et au fonctionnement de leur organisation sociale, par rapport aux temps de transmission dont l’efficacité n’était perceptible qu’à moyen et long terme. Talonnés par l’urgence, ils ont dû, tout au long de leur histoire, donner la priorité à ce qui leur permettait de répondre à leurs besoins fondamentaux : se protéger, se nourrir et se défendre. Certes, au sein de ces activités, ils ont été contraints, très tôt, de ménager des enclaves formatives afin d’éviter aux nouvelles générations d’avoir à réinventer sans cesse les savoir-faire que les précédentes avaient découverts et stabilisés. Mais, de toute évidence, ces temps ont dû toujours être gagnés, conquis de haute lutte, face aux impératifs du moment qui se donnent toujours, inévitablement et impérativement, comme prioritaires. On aurait tort de penser qu’il n’en est plus ainsi. Certes, nous avons progressé depuis l’époque où les corporations bataillaient pour conserver des temps spécifiques consacrés à la formation des apprentis ; nous avons légiféré et imposé le droit à la formation que revendiquaient depuis longtemps les organisations professionnelles et syndicales ; nous avons aussi réussi à faire accepter que la formation continue ne soit pas exclusivement consacrée à l’acquisition de compétences techniques directement utilisables dans la pratique… Mais, n’en doutons pas : tout cela reste fragile. Aujourd’hui encore, la formation des adultes est constamment assignée à faire preuve de son efficacité. Il lui faut, en permanence, justifier de son existence… car les urgences de la production, à l’atelier, comme sur le terrain ou dans les bureaux, frappent constamment à la porte : « Avec tout le travail que nous avons, ce n’est pas le moment de partir en formation ! » À vrai dire, ce n’est que rarement le moment… Ou alors, c’est que, justement, il n’y a pas de travail et qu’il faut bien « occuper les gens ». On n’en a donc jamais fini d’expliquer qu’une formation est importante, nécessaire et utile. Et l’inflation des évaluations de toutes sortes est là pour en témoigner… Il n’est donc pas étonnant qu’on ait demandé à Philippe Carré, un des meilleurs connaisseurs de la formation des adultes en France, de réfléchir sur « l’efficacité pédagogique en formation d’adultes ». Il s’y est plié de bonne grâce et nous offre un rapport particulièrement important sur cette difficile – et probablement insoluble – question. Il faut lui savoir gré de nous épargner de fastidieuses statistiques qu’il aurait pu obtenir en collectant une multitude de questionnaires de satisfaction ou d’acquisition : en réalité, au regard de la pluralité des modalités de formation qu’il explore ici et de la diversité des situations concernées, elles n’auraient guère été convaincantes. En revanche, il a interrogé de nombreux acteurs et chercheurs de la formation d’adultes et s’est livré à une analyse rigoureuse de leurs discours. Il nous montre ainsi que la notion d’efficacité ne peut nullement renvoyer à la promotion d’une « méthode miracle », pas plus qu’elle ne peut espérer être mesurée par une évaluation parfaitement objective. C’est que l’efficacité est, en réalité, le résultat d’une exigence d’efficacité et que cette exigence requiert la prise en compte conjointe de deux éléments : le « processus d’apprentissage » et la « procédure de formation ». Pas d’efficacité sans une connaissance et une référence constantes à ce que nous savons et observons de « l’acte d’apprendre ». Et pas d’efficacité sans une élaboration rigoureuse de dispositifs de formation, dans leur dimension didactique, technologique et socio-organisationnelle. Plus encore. Pas d’efficacité sans une dialectique constante entre ces deux données : quand on interroge les dispositifs au regard du processus d’apprentissage et quand on se demande ce que le processus d’apprentissage nous dit des dispositifs à mettre en œuvre. Car on touche là à ce qui est le nœud de toute formation : la rencontre, sur des objectifs précis, entre des personnes singulières qui ont décidé de se former et des formateurs ou formatrices qui maîtrisent des savoirs et des méthodes. Une rencontre qui n’est ni une addition, ni une juxtaposition, mais un travail d’assimilation et d’accommodation réciproques des deux acteurs. Un travail qui, certes, se prépare en amont mais aussi se régule en permanence et au long cours, tant il est vrai que ce qui se passe là, aujourd’hui et maintenant, ne s’est jamais passé auparavant et ne se passera plus jamais. Un travail qui impose donc aux formateurs et formatrices d’être de véritables concepteurs-régulateurs, en alliance avec des formés qui, parce que ce sont des adultes et que le métabolisme de l’apprentissage requiert toujours leur engagement, ne peuvent être considérés ni comme de simples récepteurs, ni comme des consommateurs ou des clients. Décidément, il fallait bien s’interroger sur « l’efficacité en formation d’adultes » : « un trésor était caché dedans ». Philippe Meirieu
|