|
Rentrée 1997 : Claude Allègre est ministre de l'Éducation nationale depuis quelques mois. Il a déjà, à l'occasion, suscité le mécontentement des enseignants par quelques déclarations iconoclastes. Mais il a, aussi, commencé à travailler sur plusieurs chantiers qui lui tiennent à coeur : l'amélioration de la gestion des personnels par « la déconcentration du mouvement », le développement des nouvelles technologies, la création des « aides éducateurs », l'harmonisation universitaire européenne. Le nouveau ministre affirme avec force la nécessité de travailler à améliorer la qualité du service public d'éducation. De toute évidence, il veut faire bouger le système. L'opinion, toujours friande de formules, retiendra plutôt qu'il veut « dégraisser le mammouth »... En octobre, Claude Allègre - que je ne connais alors absolument pas - m'invite à échanger avec lui sur les priorités de son ministère. Je lui fais part de mes travaux, qui portent, pour l'essentiel, sur le collège, et lui dis qu'il y a urgence à donner à ce que chacun s'accorde à considérer comme « le maillon faible du système scolaire » une impulsion nouvelle. Il se montre réticent et m'explique que, d'une part, la réforme de son prédécesseur, François Bayrou, n'est pas encore venue à son terme et que, d'autre part, la question essentielle pour l'avenir réside, à ses yeux, dans l'articulation du lycée et de l'enseignement supérieur. Il veut absolument élever le nombre et la qualification des étudiants de l'université et doit, pour cela, travailler en amont, au niveau du lycée, inadapté, à ses yeux, à l'entrée dans le supérieur. Par ailleurs, il est sensible, en tant que scientifique lui-même, à la nécessité d'adapter les contenus disciplinaires au renouvellement des connaissances. Il trouve que les lycéens travaillent de manière trop dispersée et superficielle. Il considère qu'il est temps de remettre en chantier le découpage des filières et les équilibres disciplinaires. Enfin, il fait état de ses inquiétudes sur « l'état d'esprit des lycéens », non qu'il craigne les manifestations (la suite lui donnera tort sur ce point !), mais parce qu'il pressent une forme de malaise chez ces derniers, quelque chose comme le sentiment d'être infantilisés, alors que, dit-il, certains sont déjà majeurs... En réalité, sa décision est déjà prise : il va ouvrir le chantier du lycée. Tout va ensuite aller très vite : quelques jours plus tard, Claude Allègre me demande de piloter une consultation nationale sur le thème « Quels savoirs enseigner dans les lycées ? ». Simultanément, il demande à Edgar Morin d'animer une réflexion scientifique au plus haut niveau et avec les plus grands experts sur l'évolution des connaissances et ses conséquences sur les programmes scolaires. Chacun de nous deux doit constituer un petit groupe et se mettre au travail au plus vite. Le groupe d'Edgar Morin s'intitulera « comité scientifique », le mien « comité d'organisation ». Nous devrons rendre nos conclusions au plus tard en mai 1998 afin que la réforme puisse entrer en application en septembre 1999.
Une consultation parfaitement libre... Dès ma nomination comme « chargé de mission » (1) et passée la conférence de presse qui donna à cette opération des objectifs très larges, je réunis autour de moi une petite équipe et nous nous mîmes au travail. Aucune modalité n'était arrêtée par le ministre. Nous avions quartier libre et le ministre - j'en témoigne ici - n'intervint jamais dans notre travail. Ses conseillers se tenaient régulièrement au courant et nous aidaient à résoudre tous les problèmes logistiques qui survenaient. Sur le fond, ils nous laissèrent mener l'opération comme nous l'entendions. Immédiatement, l'idée s'imposa de consulter très largement tous les acteurs du lycée : les professeurs, bien sûr, à partir de questions concernant le statut, les évolutions et l'enseignement de leurs disciplines, les établissements en tant qu'entité - associant, en particulier les parents d'élèves - et les élèves eux-mêmes. Une telle opération n'avait jamais été menée sous cette forme et les difficultés d'organisation furent très nombreuses. L'Éducation nationale est un système complexe et, en 1997-1998, l'informatisation était loin d'être aussi avancée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Toucher tous les acteurs et dépouiller la masse des informations recueillies était un véritable casse-tête. Nous décidâmes de constituer des comités académiques que nous associâmes très tôt à l'organisation de l'opération : nous voulions, avec eux, constituer un véritable maillage territorial pour animer la consultation. Ils firent un travail extraordinaire et, sous leur impulsion, tous les rouages de l'institution se mirent en marche efficacement. La presse s'intéressa très tôt et massivement à l'opération et se focalisa sur l'un des trois volets : le questionnaire à destination des lycéens. Cette focalisation constitua, alors, un gros handicap pour nous. Elle pouvait laisser croire que les questionnaires à destination des enseignants et des établissements n'étaient qu'une couverture et que nous organisions une sorte de « défouloir lycéen » qui visait à faire plébisciter par les jeunes une politique déjà décidée à l'avance. Or, il n'en était absolument rien : non seulement, j'ignorais, au début de l'opération, les intentions personnelles de Claude Allègre en matière de réorganisation du lycée, mais, de plus, quand elles nous apparurent et qu'elles nous semblèrent contradictoires avec le résultat de la consultation, nous restâmes sur les positions qui nous semblaient faire consensus. Ainsi en fût-il, par exemple, de l'organisation générale des filières et séries que le ministère souhaitait remettre en cause et qui était massivement considérée tant par les lycéens que par leurs professeurs comme un élément structurant et satisfaisant du lycée. Le ministre prit d'ailleurs, à de très nombreuses reprises, ses distances avec notre travail : jamais il ne défendit le questionnaire auprès des lycéens « que des professeurs avaient élaboré librement » ni ne prit parti publiquement pour soutenir le dispositif que nous avions mis en place. Plusieurs fois, il déclara « Je ne suis pas Monsieur Meirieu et je n'approuve pas toutes ses positions »... Tout en demandant fermement, par ailleurs, à tous les cadres de l'Éducation nationale de tout faire pour nous faciliter la tâche.
Sous le feu croisé des critiques... Très vite, les critiques fusèrent et se développèrent tous azimuts. Elles portèrent, tout à la fois, sur des questions de principe et des problèmes de méthode . Sur les principes , nombreux étaient ceux qui étaient scandalisés par le fait qu'on puisse interroger les lycéens sur leurs études. Les élèves, faisait-on valoir, reçoivent un enseignement qui leur est destiné et ne peuvent donc en définir ni les contenus ni les méthodes... Sinon, c'est qu'ils seraient déjà « passés de l'autre côté » : les associer à la définition de ce qu'ils doivent apprendre et de la manière dont ils doivent le faire, c'est les considérer comme déjà instruits et n'ayant plus besoin de l'être ! Comment peut-on, se demandera Régis Debray dans Le Monde du 3 mars 1998, chercher à « apprendre de ceux qui n'ont pas encore appris ce qu'il convient de leur enseigner » ? « Comment croire , s'interrogera l'Association des professeurs de philosophie dans son bulletin de janvier 1998, en la sincérité républicaine d'un ministère qui demande, par le biais d'un questionnaire adressé à tous les élèves s'ils s'ennuient à l'école ? » Beaucoup de critiques se cristallisèrent, en effet, sur les questions que nous posions sur l'ennui. Nous demandions effectivement aux lycéens : « Qu'est-ce que vous jugez important d'apprendre au lycée mais qui vous ennuie ? » et, tout de suite après : « Pensez-vous qu'il y ait un remède à cet ennui ? Si oui, lequel ? » Que n'a-t-on pas entendu sur ces deux questions : nous faisions de l'ennui le seul critère de l'intérêt et de l'importance de l'enseignement ! Nous transformions les professeurs en animateurs de télévision censés séduire à chaque instant leurs élèves ! Nous livrions le lycée aux caprices de barbares incultes et découragions tout effort ! Ces critiques nous apparurent particulièrement absurdes et injustes. Sans doute nos contempteurs vivaient-ils sur une sorte de déni de leur propre histoire scolaire - qui ne s'est jamais ennuyé à l'école ? -, refusant d'en reconnaître les difficultés et exaltant systématiquement leurs propres réussites ? Peut-être certains enseignants trouvaient-ils insupportable qu'on rappelât ainsi publiquement le caractère aléatoire de la relation pédagogique ? Ou considéraient-ils comme indécent qu'on mette à jour la difficulté constitutive - mais tellement stimulante - qu'il y a à vouloir organiser la rencontre, dans le cadre d'une classe à l'espace et au temps contraints, entre la volonté d'enseigner et le désir d'apprendre ? Et pourtant, on trouvait déjà, dans le Dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, un article publié en 1882 où E. Pécaut écrivait : « Qui n'a été frappé, en pénétrant dans la cour d'un de nos grands établissements d'enseignement secondaire, de la mine maussade, éteinte, ennuyée, d'un grand nombre de jeunes garçons ? Qui ne les a vus, dans la classe, subir les leçons comme une corvée monotone, sans que leur visage s'animât, sans que le moindre tressaillement vint annoncer que le coeur prenne part à l'effort de l'intelligence ? Qui ne sait que, l'éducation terminée, un trop grand nombre d'entre eux se hâtent d'oublier une époque de leur vie qui, par leur faute ou par celle de leurs maîtres, ne leur apparaît que comme un temps de labeur ingrat et ennuyeux ? » Voilà donc une question que les « républicains » d'aujourd'hui trouvent scandaleuse quand un des fondateurs de « l'École de la République » osait, lui, l'aborder franchement ! Et voilà une indignation de philosophes - dont on peut légitimement attendre une lecture rigoureuse des documents - qui ne se donne même pas la peine de regarder de près ce qu'on demandait exactement aux lycéens : non pas s'ils s'ennuient en classe, mais bien « s'il existe des éléments qu'ils jugent importants , mais qui les ennuient ». Avec un objectif particulièrement évident pour tout observateur de bonne foi : faire réfléchir sur l'écart entre « l'importance » et « l'intérêt ». Ce qui est « important » n'est pas toujours « intéressant » et vice-versa : qui peut dire sérieusement que c'est là une question sur laquelle il est inutile que les élèves réfléchissent ? Qui ne voit que la réussite scolaire exige précisément d'avoir travaillé, de travailler sans cesse sur cette distinction ? Et comment oublier le caractère essentiel de la question qui venait tout de suite après : « Pensez-vous qu'il y ait un remède à cet ennui ? Si oui, lequel ? » C'est là une question qui émane d'un principe simple : « Nul ne peut critiquer sans proposer ». Un principe citoyen que, mine de rien, nous proposions aux élèves d'appliquer et qu'il serait bon, d'ailleurs, de mettre en oeuvre plus systématiquement dans le système scolaire.... Et puis ceux et celles qui nous taxèrent alors de « sociolâtrie » et de « puérolâtrie », de « dangereux alchimistes cherchant à mettre l'intellectualité des professeurs au pas du conformisme social » (2) auraient quand même pu noter - par simple honnêteté intellectuelle - notre insistance sur un point majeur de la consultation lycéenne : les professeurs étaient, en effet, invités, au sein des établissements, à accompagner le remplissage du questionnaire. Nous leur avions demandé de le présenter et d'en commenter les questions, d'organiser un débat sur chacune d'entre elles afin de favoriser la réflexion individuelle. Nous pensions que c'était là leur travail, précisément pour éviter que cet exercice devienne un simple défoulement. Or, les professeurs n'ont pas massivement endossé ce rôle. Certes, nous n'avons pas eu les moyens de savoir exactement comment les choses se sont passées : dans certains cas, effectivement, plusieurs heures ont été consacrées au questionnaire, sous la responsabilité du professeur principal. Dans d'autres, celui-ci a été déposé sur un coin de table ou jeté sur un bureau avec une consigne évasive : « Faites ce que vous voulez de cette foutaise ! ». Entre les deux, une multitude de cas de figure et, sans doute, une grande majorité de lycéens abandonnés à eux-mêmes. Et une immense satisfaction pour nous au bout du compte : ils l'ont quand même pris au sérieux et plus de deux sur trois ont pris la peine de le remplir. Mais à côté de l'attaque des philosophes, nous dûmes subir aussi les critiques de plusieurs sociologues qui mirent en question la rigueur de notre démarche . C'est que deux opérations, apparemment de même nature, avaient été menées avant peu de temps avant nous, l'une sous l'autorité du prestigieux Pierre Bourdieu, l'autre dans le cadre de ce que l'on a nommé « le questionnaire Balladur ». Chaque fois, d'éminents sociologues avaient été associés au projet, garantissant la possibilité du traitement scientifique des réponses. Par ailleurs, huit ans plus tôt, en 1990, un puissant mouvement lycéen avait amené Lionel Jospin, alors ministre de l'Éducation nationale, à initier une réforme des lycées, accordant aux lycéens des droits significatifs en matière d'expression, de réunion, de publication, etc. On avait aussi, à cette occasion, mis en place les « modules » censés apporter aux élèves des perspectives nouvelles par rapport à l'enseignement traditionnel : une première ouverture pour des activités transdisciplinaires originales, malheureusement souvent dévoyées en simples « cours de rattrapage ». C'est ainsi que Pierre Merle, sociologue à Rennes, nous attaqua violemment, dans un article du Monde du 11 février 1998, dénonçant « l'illusion largement entretenue selon laquelle nous ne saurions rien sur les lycéens » et soulignant que la consultation des lycéens « promus pour un jour citoyens à part entière par la magie d'un questionnaire » était une lamentable parodie. Il ajoutait - en opposition évidente avec les philosophes qui nous attaquaient par ailleurs, mais en accord avec eux pour discréditer l'opération - que le fait de « solliciter la parole des lycéens » était un alibi qui permettait de les maintenir, par ailleurs, dans une situation de sujétion, d'oublier les violences institutionnelles dont ils étaient victimes au quotidien comme les ségrégations invisibles qui clivaient les lycées. Il concluait sur la nécessité de repenser radicalement « la condition lycéenne » et de « substituer la discussion au jour le jour au "grand débat" d'un seul soir... ». Le procès, ici, résidait donc dans le caractère ponctuel et « démagogique » de la consultation. Mais Pierre Merle oubliait, dans son analyse, plusieurs éléments : il isolait, victime en cela, comme bien d'autres, du traitement médiatique de l'opération, le questionnaire en direction des lycéens des autres démarches que nous avions impulsées auprès des enseignants et dans les établissements... démarches qui, précisément, avaient pour vocation d'inscrire la réflexion sur la condition lycéenne dans la durée en travaillant avec tous les acteurs sur le fonctionnement quotidien des lycées. Il oubliait également le travail extrêmement fin effectué, dans chaque établissement et dans la majorité des classes, avec les délégués d'élèves. Travail de réflexion collective au long cours qui, progressivement, remontera jusqu'aux conseils de la vie lycéenne de chaque Académie et aboutira au rassemblement national de l'Isle d'Abeau en avril 1998. Là, dans un cadre absolument inédit, huit cent lycéens, issus de tous les types d'établissements (y compris l'enseignement agricole), de métropole et d'Outre-mer, débattront longuement du statut du lycéen et proposeront des perspectives d'évolution qui seront décisives dans l'élaboration de notre rapport : c'est ainsi que nous fûmes définitivement convaincus aussi bien de l'importance de renforcer les structures participatives au lycée que de la nécessité d'instituer officiellement ce que nous nommerons « l'éducation civique, juridique et politique ». Aucun « refoulement » dans cette démarche, bien au contraire : l'effervescence qui régna lors du rassemblement de l'Isle d'Abeau et les retombées ensuite sur le terrain peuvent en témoigner. Il n'est d'ailleurs pas certain que les mouvements lycéens de l'année 1998-1999 ne soient pas, en partie, nés dans cette démarche ou, au moins, qu'ils n'aient pas été alimentés par tout le travail de réflexion que nous avions initié alors. Et ce sont ces mouvements qui accélèreront notablement la mise en place de nouvelles instances de participation dans les lycées. Mais, à côté de l'accusation qui nous était faite d'anesthésier les lycéens à travers une fausse consultation, nous dûmes subir aussi, de la part de beaucoup, de fortes remises en question sur la méthodologie de la consultation : « un questionnaire présentant des questions trop ouvertes et inexploitables, une identification lacunaire des lycéens sur leur origine sociale, un dispositif de dépouillement hétérogène et marqué par son amateurisme ». Bref, comme le soulignait aussi Pierre Merle dans le même article, nous étions « dans l'impossibilité d'opérer une exploitation analytique et rigoureuse de l'ensemble des questionnaires ». Et il est vrai que le questionnaire à destination des lycéens avait été conçu par des pédagogues et non par des sociologues. Avec le souci de chercher ce qui ferait le mieux réfléchir les élèves. C'est pourquoi, après en avoir longuement débattu entre nous, nous avions préféré maintenir des questions qui nous paraissaient pédagogiquement importantes, en dépit de la difficulté de leur traitement statistique. Nous refusions de nous laisser enfermer dans le principe que « ce qui n'est pas statistiquement mesurable n'a pas d'importance ». Et nous avons effectivement avancé avec une forme de « volontarisme amateur », en pensant que les problèmes méthodologiques seraient traités au fur et à mesure et qu'ils ne devaient pas nous paralyser à l'avance. Il n'est évidemment pas certain que nous ayons réussi dans ce domaine. Néanmoins, je reste convaincu que ce que nous avons mis en place était défendable : le comité national d'organisation a fait procéder, en effet, à un dépouillement de cinq mille questionnaires tirés au sort de manière aléatoire en veillant à l'hétérogénéité de leur provenance ; une équipe les a dépouillés en fabriquant une typologie des réponses possibles pour chaque question et a construit un logiciel qui a été proposé ensuite à tous les comités académiques. Un tiers de ces derniers l'ont utilisé. Les autres ont élaboré eux-mêmes leurs outils en fonction de leurs ressources et de la configuration de l'équipe à leur disposition : ici, c'est un laboratoire universitaire de sociologie ou de sciences de l'éducation qui s'est chargé du travail, ailleurs ce sont des enseignants en formation qui ont lu l'ensemble des questionnaires et, de proche en proche, en ont élaboré la synthèse. Au total, ce sont bien 1 812 109 questionnaires qui ont été dépouillés. Avec des consignes identiques et des méthodologies différentes. Et, au final, une remarquable convergence des résultats. On peut ainsi légitimement penser que les différences des approches, loin d'invalider nos conclusions, les confortaient : puisque, quelles que soient les méthodes utilisées, on débouchait à peu près sur les mêmes constats, c'est qu'ils devaient être assez largement partagés... Huit ans après, le travail remarquable et scientifiquement incontestable qu'on va lire, mené sous la responsabilité de Roger Establet, semble nous donner raison. Certes, il apporte de précieux compléments et d'indispensables nuances ; il insiste sur des points que nous avions peut-être insuffisamment analysés à l'époque ; il va dans le détail et nous éclaire sur des distinctions et des points communs de manière tout à fait originale ; il constitue à cet égard un travail de professionnel d'une tout autre rigueur que celui que nous avions mené dans l'urgence... Mais il ne dément pas nos principales conclusions et c'est là, pour les organisateurs de la consultation, un motif réel de satisfaction.
De la consultation aux propositions... En réalité, comme nous avions tenté de le faire entendre - en vain - à l'époque, la plupart des critiques qui ont été faites sur le moment à la consultation de 1998 relevaient d' une incompréhension de notre démarche . Il ne s'agissait nullement, en effet, d'une enquête ou d'un sondage. Si nous avions voulu savoir avec précision l'opinion des lycéens sur leurs études, un échantillon d'un millier de personnes aurait suffi. Mais l'enquête et le sondage n'ont pas de caractère mobilisateur, ils n'impulsent pas un mouvement de réflexion collective ; ils donnent simplement une photographie exacte des opinions à un moment donné. La consultation, en revanche, au moins telle que nous l'avions conçue, devait susciter une dynamique : il ne s'agissait pas de recueillir des points de vue préexistants, mais d'engager chacun et chacune à réfléchir et à s'exprimer. Dans une enquête ou un sondage, les résultats préexistent au questionnaire et l'objectif est de faire émerger le plus exactement possible ce qui est déjà là. Dans la consultation des lycéens, nous avions l'ambition de leur permettre de dépasser les formules toutes faites, de s'exhausser au-dessus des clichés, des réactions épidermiques, des mimétismes groupaux. Nous avons cherché des questions capables de déclancher un débat intérieur ou de favoriser la discussion entre élèves. Certes, nous sommes restés maladroits et, en dépit des passations « à blanc » que nous avons effectuées pour tester le questionnaire, certaines formules sont restées ambiguës. La plus significative, à cet égard, est l'expression de « cours magistral » que nous avions placée dans une liste assez longue des méthodes permettant la réussite d'un apprentissage (3) : quelle n'a pas été notre surprise, au cours de nombreux débats que nous avons eus avec des élèves dans les lycées, d'entendre certains d'entre eux nous interpeller : « Des cours magistraux, on aimerait bien en avoir, mais nos cours, vraiment, ils ne sont pas souvent "magistraux" » ! »... Au total et avec le recul, à la lecture, en particulier, du présent ouvrage, il semble que le pari périlleux d'une consultation qui « fait penser » et permet d'avancer dans l'exercice de l'intelligence individuelle et collective n'ait pas été complètement perdu. Puissent les enseignants, les cadres du système éducatif et les hommes politiques qui nous gouvernent entendre la leçon : les lycéens ne sont pas condamnés à être manipulés et à réagir sous forme de chahuts collectifs irresponsables. Dès lors qu'on s'adresse à eux avec confiance et qu'on les implique dans une réflexion sérieuse, ils sont capables de « jouer le jeu » et de beaucoup nous apprendre. Reste alors un dernier malentendu : un questionnaire aux lycéens, une consultation des professeurs et des établissements sont-ils, pour autant, susceptibles, dès lors qu'ils seraient correctement conduits, de « produire » une réforme de l'École ? Nous ne l'avons jamais imaginé : aussi constructives soient les réponses et les propositions, il existe bien toujours une rupture radicale entre « la consultation » et « la prise de décision ». D'abord parce qu'en matière pédagogique et scolaire, comme partout ailleurs, les décisions ne sont jamais « contenues » dans les diagnostics ; les décisions relèvent de l'inventivité des hommes et de leur capacité à mettre en regard des finalités, des contraintes et des ressources. Les décisions sollicitent la création de chemins qui ne sont jamais tracés d'avance ; elles mobilisent la capacité à anticiper, à peser les risques et à préparer des scénarios qui permettent au souhaitable d'advenir. Rien de mécanique dans tout cela et si, à cet égard, les experts et les consultations de toutes sortes éclairer les décisions des politiques, ils ne peuvent, en aucun cas, se substituer à eux. La politique reste l'affaire des politiques et des citoyens. Des politiques qui proposent des choix et des citoyens qui les approuvent ou les sanctionnent. C'est pourquoi le comité d'organisation de la consultation n'a jamais imaginé le moins du monde que ses propositions puissent être adoptées telles quelles par le ministre et le gouvernement. Cela ne veut pas dire que nous n'avions pas acquis des convictions fortes, bien au contraire. Mais nous n'ignorions pas que ce n'était que des propositions... et que, de toute façon, nous n'aurions pas le dernier mot. Cela ne nous a pas empêché de nous battre longuement et de développer des trésors d'imagination pour convaincre les décideurs et l'opinion publique que la clé de l'évolution du lycée, de l'amélioration des apprentissages, de l'implication des lycéens dans leurs propres études, de la lutte contre l'injustice sociale et pour la démocratisation de l'accès aux savoirs était bien « la redéfinition des missions et du service des enseignants ». Nous étions convaincus, en particulier après avoir écouté les lycéens, que les professeurs, à côté de leurs activités d'enseignement en classes complètes (ce que l'on nomme habituellement « les cours ») devaient investir dans le suivi individualisé des élèves (qui ne peut rester l'apanage des officines privées de soutien scolaire), l'aide à la recherche documentaire sur des objets transdisciplinaires (qui représente une exigence essentielle pour aborder l'enseignement universitaire dans de bonnes conditions), l'organisation de stages d'expression artistique ou de formation à l'usage intelligent des nouvelles technologies (qui pourraient efficacement compenser les inégalités sociales dans ce domaine et utiliser les trop longs moments d'inutilisation des équipements et locaux scolaires). Nous pensions qu'une multitude d'activités que les enseignants font aujourd'hui presque clandestinement, entre deux cours (comme recevoir les parents, donner un conseil méthodologique ou de lecture à un élève, l'aider à choisir son orientation, organiser l'entraide dans une classe, etc.), devaient être reconnues comme participant pleinement de leurs missions. Nous croyions que le suivi des stages en entreprise dans les lycées professionnels, l'encadrement d'activités prévues par le projet d'établissement, l'organisation de l'élection des délégués et l'animation de la classe, la concertation avec les collègues, tout cela devait être institué au coeur du lycée et non soumis à l'aléatoire des bonnes volontés et du volontarisme du chef d'établissement. Il y avait là, pour nous, une exigence fondamentale pour avancer vers une prise en compte de l'élève comme acteur de sa propre scolarité, au coude à coude plutôt qu'en face à face avec ses professeurs. Conjuguer, dans le lycée, socialisation et apprentissages, sans sacrifier aucunement ni la première ni les seconds, nous semblait devoir passer par une « révolution » dans la manière de concevoir le métier de professeur. Non pour en réduire les ambitions ou le transformer en animateur socioculturel, mais pour lui donner vraiment, au sens le plus noble du terme, les moyens de transmettre . Transmettre, comme jadis les compagnons du Tour de France transmettaient, sans renoncer en rien à leurs compétences propres. Transmettre, comme l'École de la République l'a toujours voulu, sans exclure quiconque des fondamentaux de la citoyenneté. Transmettre, pour prendre le contre-pied des facilités de notre « société de communication », en étant exigeant sur les contenus, fermes sur la rigueur, la précision et la justesse, et solidaires face aux inévitables difficultés qui surgissent. (4)
Des propositions à la réforme... On sait que, sur la question du service enseignant, nous n'avons pas été suivis par Claude Allègre qui chercha désespérément, à l'automne 1998, à se réconcilier avec ses adversaires - en particulier le principal syndicat d'enseignants du second degré, le SNES - et ne parvint - comme chaque fois qu'on procède ainsi - qu'à décourager ceux qui le soutenaient et à s'aliéner ses propres amis.Le projet de redéfinir les missions et le service enseignant sera cependant repris, sous une autre forme, sept ans plus tard, par le rapport Thélot, avant d'être écartée à nouveau par François Fillon : de toute évidence, c'est là un sujet tabou et le courage politique manque cruellement pour l'aborder. Pour autant, si nous n'avons pas convaincu dans ce domaine, il y eut bien, en 1999, une « réforme des lycées » et un certain nombre de mesures furent prises. Elles sont loin d'être insignifiantes. On développa, d'abord, les instances de formation à la vie démocratique, en mettant en place, dans chaque lycée, un Conseil de la vie lycéenne . Certes, cela ne fut pas exempt de dérapages et, faute d'une véritable formation à l'exercice de la démocratie représentative, ces conseils fonctionnent parfois encore comme de simples « soupapes de sûreté ». Rares sont les cas ou ils se saisissent de questions importantes comme le travail à la maison, la recherche documentaire, l'organisation du travail de groupe en classe ou les conditions d'une plus juste évaluation. Le plus souvent, ils ne traitent que de questions mineures, anecdotiques, incapables de mobiliser les élèves et de contribuer à leur « socialisation scolaire ». La réforme a été appliquée de manière formelle et beaucoup - l'essentiel, sans doute - reste encore à faire dans ce domaine... Le ministère s'engagea également, dès 1999, vers un renouveau de l'éducation artistique : généralisation de celle-ci dans les trois voies du lycée (y compris l'enseignement professionnel qui en était scandaleusement privé et où les lycéens en étaient très demandeurs) et développement d'ateliers en partenariat avec des artistes. Un an plus tard, Jack Lang mettra en place les classes à Projet artistiques et culturel (classes à PAC) dans le cadre du Plan de relance des arts à l'école. Un grand espoir et de belles initiatives fleurirent alors. Avec, pour beaucoup d'enseignants, le sentiment d'être enfin reconnus comme de véritables « vecteurs culturels » et, pour beaucoup de lycéens, la satisfaction de pouvoir accéder à des modes d'expression jusque-là réservés à un petit nombre de privilégiés. Mais on sait ce qu'il en advint quand le gouvernement changea : les moyens consacrés à ce « supplément d'âme » furent récupérés pour « l'enseignement des fondamentaux ». Mauvais calcul : les fondamentaux de la culture scolaire ne prennent sens pour l'élève que si ce dernier a la possibilité de les comprendre dans une dynamique qui leur donne sens. L'obsession des bases - aujourd'hui transformées en « socle » - fait des ravages. Tout cela relève d'une « pédagogie des préalables » absurde. Ainsi, faudrait-il attendre de savoir nager pour avoir le droit d'aller à la piscine. Attendre de savoir lire pour pouvoir ouvrir des livres. Attendre de savoir écrire, parfaitement et sans faute, pour griffonner sa première lettre d'amour. Attendre de savoir faire l'amour pour faire l'amour. La « pédagogie des préalables » place toujours « les savoirs » comme un condition indispensable en amont de « la culture ». La « pédagogie des préalables » trouve toujours des prétextes pour reculer le moment de la confrontation avec la culture : « Il manque de bases ; il lui faut d'abord consolider ses acquis ; le temps fait défaut et il vaut mieux se concentrer sur les bases... » En réalité, la « pédagogie des préalables » coupe les ponts qu'elle prétend construire. Elle empêche les élèves - en particulier les plus démunis et les plus fragiles qu'on retrouve souvent en lycée professionnel - d'entendre la vie gronder derrière les connaissances fossilisées que l'École leur enseigne. Elle fabrique de la mort avec du vivant... quand il faudrait, à l'évidence, faire le contraire : restituer le projet culturel qui a donné naissance aux savoirs. Troisième mesure de la réforme des lycées de 1999 : la mise en place de deux heures d'aide individualisée en classe de seconde . Dévolues au français et aux mathématiques, ces deux heures ne devaient pas s'effectuer avec des groupes de plus de huit élèves et pouvaient, de semaine en semaine, varier en fonction des difficultés rencontrées et des résultats des diverses évaluations. En début d'année, une évaluation globale était prévue pour diagnostiquer les besoins des élèves et permettre à l'équipe pédagogique de mettre en place, dans le cadre de l'aide individualisée, des « groupes de besoin » ciblés... Belle initiative, mais fort difficile à mettre en place ! Toutes les expériences de ce type, depuis la « pédagogie de soutien » instituée par René Haby au moment de la création du collège unique jusqu'au « contrat individualisé de réussite éducative » proposé par François Fillon dans le cadre de la « loi d'orientation sur l'avenir de l'école », se heurtent aux mêmes problèmes et s'engagent, à terme, vers les mêmes dérives. Comment identifier les élèves qui ont besoin de ces heures et comment les regrouper sans les stigmatiser ? Comment éviter que ces heures ne se transforment en simple rattrapage pour les élèves lents et laissent de côté les élèves en échec ou en rupture que l'on continuera à traiter par l'exclusion ? Comment lutter contre la terrible tentation de récupérer ces heures en classes complètes pour finir un programme toujours trop lourd ? Ainsi, les heures d'aide individualisées ont-elle été utilisées de manière très inégale et, globalement, sans qu'on puisse en tirer un bilan positif. L'évaluation de début de seconde, qui était un bon levier pour le travail en équipe et pouvait permettre d'organiser des dispositifs souples et originaux, a été récemment rendue facultative. Autant dire que, très vite, elle n'existera plus du tout. L'absence actuelle d'impulsion pédagogique dans le sens d'une pédagogie véritablement différenciée, le peu d'importance accordée au projet d'établissement, l'affirmation démagogique dans la « loi d'orientation sur l'avenir de l'école » d'une « liberté pédagogique » jamais véritablement contestée... tout cela invite au repli, au chacun pour soi et à la disparition progressive d'une mesure qui n'aurait trouvée tout son sens que dans une reconfiguration progressive de toute la scolarité. Quatrième mesure : la mise en place de l'Éducation civique, juridique et sociale (ECJS). L'introduction de cet enseignement nous était apparue absolument essentielle dans la perspective d'une véritable formation du citoyen au lycée. Les lycéens nous avaient dit, en effet, leur désarroi devant un monde dont ils ne détiennent pas les clés, leur souci de comprendre les grands enjeux contemporains sur lesquels ils n'ont qu'un éclairage sommaire des médias, déconnecté des savoirs scolaires, leur volonté, aussi, de pouvoir débattre des questions de société avec l'aide de leurs professeurs. Les lycéens des lycées professionnels avaient insisté, de leur côté, pour que l'on introduise la philosophie dans leur cursus : ils se sentaient, en effet, mis à l'écart et souhaitaient ardemment ne pas être cantonnés dans une vision utilitariste de la culture. Nous avions, pour notre part, beaucoup insisté sur le caractère fondamental de cette introduction, imaginant, par ailleurs, que cela contribuerait à renouveler opportunément les méthodes de cet enseignement. Mais l'opposition farouche de l'immense majorité des professeurs de philosophie - qui continuent à considérer leur discipline comme « le couronnement » des seules études secondaires générales - et le coût de la mesure avaient découragé le ministre. C'est pourquoi nous avions suggéré la mise en place dans tous les lycées d'un nouvel enseignement, confié prioritairement - mais pas seulement - aux professeurs d'histoire et de géographie, et comportant des apports en matière de droit (le grand absent des disciplines d'enseignement secondaire, alors qu'il est fondateur du fonctionnement de nos sociétés démocratiques), de sciences économiques et sociales, d'histoire et de philosophie. Au coeur de cet enseignement, nous avions placé le travail documentaire et la pratique du débat, avec la volonté de ne surtout pas dissocier ces deux aspects : parce qu'aucun débat intéressant ne peut se développer sur du vide, en l'absence de références, de textes et de données... et parce que la recherche documentaire est une formation citoyenne si, et seulement si, elle permet de mettre en débat les convictions des uns et des autres, d'engager une dialectique fondatrice du « savoir » et du « juger ». Porté efficacement par les corps d'inspection et mise en oeuvre par des enseignants motivés, l'ECJS a donné lieu, dès la rentrée 1999, à de belles initiatives... Bientôt, malheureusement, brisées dans leur élan par les réductions de moyens, l'abandon du projet de l'évaluer au baccalauréat et les remises en cause idéologiques de ceux et celles pour qui, probablement, la formation du citoyen n'est pas, aujourd'hui, une priorité. Avec le changement de majorité politique, l'ECJS diminuera comme une peu de chagrin. Enfin - cinquième axe de la réforme de 1999 - le ministère instaura les Travaux personnels encadrés (TPE) en première et terminale (5) . C'était là un moyen privilégié, à nos yeux, pour contribuer à l'émergence d'une nouvelle « identité lycéenne ». Sous la responsabilité d'un « enseignant tuteur », les élèves, seuls ou en petits groupes, avaient à traiter, sous forme de dossier, un sujet portant sur deux des disciplines dominantes de leur série. En étroite collaboration avec le documentaliste, les professeurs devaient encadrer ces travaux en étant attentifs, tout à la fois, à la rigueur des informations disciplinaires, à l'effort pour articuler des savoirs issus de disciplines différentes, comme à la qualité de l'exposé écrit et de l'iconographie utilisée. De plus, ils accompagnaient l'élaboration du dossier final dans la durée, soucieux d'aider les élèves à planifier leurs efforts, à se fixer et à respecter des échéances... La mise en place des TPE ne fut pas simple, car ce mode de travail renverse, à bien des égards, la culture dominante dans les lycées, celle de la juxtaposition de disciplines qui s'ignorent et de la délégation à la bonne volonté de chaque élève du devoir d'effectuer des mises en relation et des synthèses. Mais, en revanche, les TPE s'inscrivaient parfaitement dans la demande des élèves de construction d'une nouvelle « culture lycéenne » fondée sur une articulation forte entre des contenus disciplinaires exigeants et une relation pédagogique fondée sur l'aide et la confiance. À ce titre, les TPE nous sont apparus, d'emblée, comme une perspective particulièrement intéressante de dépassement des paradoxes qui apparaissaient dans les paroles lycéennes, une manière de satisfaire et de dépasser en même temps l'attachement légitime aux disciplines et le désir d'une pédagogie plus personnalisée... de prendre en compte et de donner forme au double souci de « plus de culture » et de « plus d'autonomie »... On a oublié, aujourd'hui, à quel point cette mise en place des TPE fut difficile et conflictuelle : le SNES, qui les défend ardemment depuis leur suppression en terminale par François Fillon, résista jusqu'au bout et de toutes ses forces à leur mise en oeuvre. Jack Lang, qui s'enorgueillit maintenant d'avoir réalisé là une « réforme essentielle », attaqua très violemment les parents d'élèves qui militaient pour accélérer et généraliser le processus. Les autorités académiques, pourtant convaincues du bien-fondé de l'initiative, hésitèrent souvent à s'engager trop fermement sur cette voie, craignant les résistances des enseignants. Or, contre toute attente et parce qu'heureusement « le pire n'est pas toujours sûr », les TPE réussirent à s'installer. Très vite, ils furent plébiscités par les élèves, et les enseignants les plus réfractaires commencèrent à se demander s'il n'y avaient pas là un dispositif intéressant... C'est le moment que l'on choisit, à l'automne 2003, pour les supprimer en terminale ! Décidément, les hommes politiques comprennent mal les lycéens. Ils ne les écoutent guère et s'étonnent ensuite de devoir essuyer, à cause d'eux, quelques déconvenues.
Lycéens : le retour... Février 2005 : Les lycéens, qui paraissaient fort calmes et ne semblaient pas avoir été émus par la présentation, quelques mois plus tôt, de la « loi d'orientation sur l'avenir de l'école », sont dans la rue. Leur revendication principale : la suppression du projet d'introduction du contrôle continu au baccalauréat. Pour les adultes de la « génération 68 » dont je suis, il s'agit là d'un phénomène bien étrange. N'oublions pas, en effet, que le contrôle continu était alors âprement réclamé par les lycéens et les étudiants qui dénonçaient le caractère de couperet de l'examen final, ses aspects aléatoires, la pression psychologique qu'il représentait et le bachotage qu'il favorisait. Pour les observateurs d'aujourd'hui, ce refus du contrôle continu est tout aussi incompréhensible : toutes les études, en effet, montrent qu'il n'introduit pas de différence significative de résultats avec l'examen final et, surtout, que l'inquiétude de voir se développer un « baccalauréat à plusieurs vitesses » est très largement dépassée. Le baccalauréat n'est plus du tout aujourd'hui un examen égalitaire : la hiérarchie entre le baccalauréat scientifique et les baccalauréats professionnels est telle que personne ne peut plus dire qu'il s'agit du même examen. C'est l'orientation en fin de troisième - non anonyme et relative à la politique de chaque collège - qui décide du destin scolaire des élèves et non le baccalauréat. Ce sont les bulletins trimestriels de première et de terminale, examinés en mars ou avril, bien avant les résultats du baccalauréat, qui décident de l'accueil dans les classes préparatoires aux grandes écoles où est formée « l'élite de la nation »... Et nul ne peut dire sérieusement que ces bulletins sont examinés indépendamment du prestige du lycée qui les délivre. Alors, de quoi les lycéens ont-ils peur ? Que dénoncent-ils vraiment ? Au coeur de leur discours, même maladroitement dénoncée, c'est bien d'injustice qu'il s'agit. Injustice qui s'accroît entre les prestigieux établissements de centre-ville, objets de toutes les convoitises, et établissements de la périphérie où les plus modestes et les moins débrouillards sont assignés à résidence. Injustice qui galope avec la concurrence que se livrent les lycées - privés et publics - pour attirer les meilleurs élèves... avec, inéluctablement, au bout du compte, une hiérarchisation des filières qui condamne les plus fragiles à la désespérance. Injustice entre les collèges « bien côtés », où enseignent la plupart des professeurs chevronnés, et les « collèges sensibles » où les débutants sont souvent nommés à leur corps défendant et où seul le dévouement quotidien de quelques saints laïcs empêche l'effondrement... Les lycéens le sentent et le disent : il n'y a plus « une École » en France ; il n'y a plus qu'une mosaïque d'établissements et une fracture scolaire qui s'agrandit de jour en jour... Seront-ils entendus ?
Pour entendre et comprendre... Car c'est bien là l'enjeu : il ne s'agit pas de donner systématiquement raison aux lycéens, ni de satisfaire toutes leurs demandes, souvent contradictoires. Ce n'était pas le cas en 1998. Ce n'est pas plus le cas aujourd'hui. Il s'agit de décider de l'avenir de notre système scolaire en conscience de ce qu'y vivent les premiers concernés. Il s'agit de savoir d'abord . Savoir ce qui se passe entre les murs du lycée et dans la tête des personnes. Pour ne pas se payer de mots. Ne pas se gargariser de formules générales qui ne convainquent personne et de projets dont l'objectif est de calmer l'inquiétude de l'opinion publique plutôt que de mettre en oeuvre une véritable formation des élèves. Il s'agit de comprendre ensuite . Comprendre comment les élèves réagissent, quelles stratégies ils développent pour survivre et progresser dans l'École. Comprendre qu'ils ne cherchent pas d'abord à « échapper » ou à « combattre » l'institution, mais, massivement, à l'améliorer. Comprendre que leurs propositions d'amélioration ne sont nullement dirigées contre leurs maîtres, mais qu'ils attendent d'eux, au contraire, une interlocution sans concession qui leur permette de les mettre à l'épreuve. Comprendre que, pour eux, le lycée est un lieu essentiel de construction de leur personnalité. Qu'ils ne récusent nullement l'autorité des adultes dès lors qu'elle est fondée sur la compétence et le respect de l'autre. Nous avons commencé à comprendre cela en 1998. Mais commencé seulement. Les faits sont là, aujourd'hui, pour prouver qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Plus que jamais nous avons besoin de nous mettre à l'écoute. Sans crainte ni inquiétude. Car, une société qui aurait peur d'entendre sa jeunesse n'aurait guère d'avenir. C'est pourquoi il faut savoir infiniment gré à Roger Establet et son équipe d'avoir repris les matériaux de la consultation lycéenne de 1998 pour écrire cet ouvrage dont je n'ai pas voulu, ici, déflorer le contenu. Ils ont fait là un travail exemplaire : minutieux sans être technocratique, précis et rigoureux, mais sans la moindre froideur chirurgicale. On aurait tort de ne pas prendre très au sérieux leurs résultats. Ils ne portent pas en eux-mêmes de solutions. Mais il n'y aura jamais de solution durable pour notre École si l'on n'écoute pas attentivement ce qu'ils nous disent. ______________________________________ (1) Contrairement à ce que dira la presse et à ce que croira l'opinion, je ne fus jamais « conseiller » de Claude Allègre. Un « conseiller » est membre du cabinet et travaille en proximité quotidienne avec le ministre. Il est tenu aussi à une stricte obligation de réserve et ne doit pas s'exprimer en son nom propre. Alors que, pour ma part, j'ai toujours bénéficié de la plus totale liberté d'action dans le cadre de ma mission et que je me suis exprimé librement - y compris pour prendre d'importantes distances, sur bien des points, avec Claude Allègre. (2) Robert Rédeker, Libération , « Adieu Professeur », 4 mars 1999. (3) Liste qui avait, pour nous, bien évidemment, un objectif pédagogique clair : faire découvrir aux élèves ce qu'est apprendre et comment on apprend. (4) Le rapport final de la consultation « Quels savoirs enseigner dans les lycées ? » peut être consulté sur ce site dans la rubrique "Rapports officiels et textes institutionnels". (5) Dans les lycées professionnels, on développa, sur le même modèle, les Projets pluridisciplinaires à caractère professionnel (PPCP). |
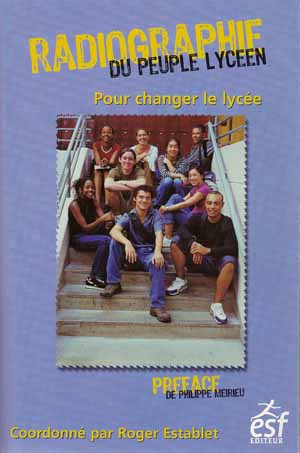 1998 - 2005 : Les lycéens au front
1998 - 2005 : Les lycéens au front