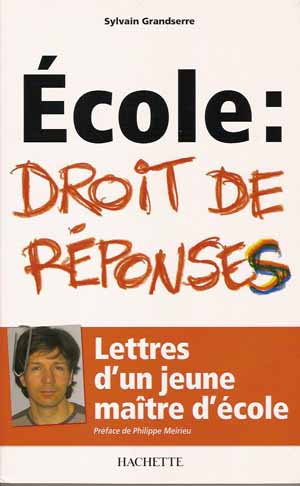|
Lever les verrous... « Ayons des professeurs qui ne songent qu’à professer, et moquons nous de la pédagogie ! » Qui a bien pu écrire cela ? Un ministre de l’Éducation nationale voyant en Mai 68 l’origine de tous nos maux et, dans la pédagogie, un dangereux abandon de l’autorité du maître au profit de l’écoute béate des aspirations des élèves ? Une association qui prétend résister à l’emprise du « pédagogisme » qui, selon elle, nous aurait fait abdiquer toute ambition pour nos élèves ? Un syndicat d’enseignants de droite, traditionnellement arc-bouté sur les formes canoniques de transmission des savoirs ? Un magazine anti-libéral dénonçant à tout va l’emprise du marché sur nos institutions et « l’alliance objective des pédagogues et de Bill Gates » ? Un philosophe-journaliste reprenant, une nouvelle fois, le discours de la décadence si cher à la tradition réactionnaire française ? Un pamphlétaire néo-trotskyste en quête de succès médiatique et de bouc émissaire facile ? Le chroniqueur d’un grand hebdomadaire – plutôt à droite, au centre ou à gauche – dénonçant, une fois de plus, « le grand gâchis de l’Éducation nationale » ? Mon voisin, ma tante, mon collègue de bureau ? Ne cherchez plus : tout le monde dit ça. C’est devenu un lieu commun de toute parole publique sur l’École : « Les pédagogues se sont agenouillés devant l’enfant, ont introduit un jargon insupportable et, au bout du compte, sont aujourd’hui responsables de la déroute de l’École et de toute notre société. » Aujourd’hui ? Vous croyez vraiment ? En réalité, la fameuse boutade - « Ayons des professeurs qui ne songent qu’à professer, et moquons nous de la pédagogie ! » - est tirée d’un ouvrage de Brunetière, Éducation et instruction, paru en 1895. Éminent intellectuel de son époque, directeur de la revue qui, alors, faisait autorité, Ferdinand Brunetière fut élu à l’Académie française contre Zola qu’il avait violemment critiqué et se fit remarquer par sa virulente campagne contre le projet d’un monument à Charles Baudelaire. Antidreyfusard notoire, il milita rageusement contre les « chaires de pédagogie » qu’il accusa de tous les maux et, en particulier, de « pervertir les professeurs par des cours d’éducation générale », quand il suffisait, selon lui, pour en faire des professionnels accomplis, de leur donner « le sentiment de la dignité de leur profession » par la maîtrise des savoirs académiques. Évitons l’amalgame : tous les contempteurs de la pédagogie n’adoptent pas les positions de Brunetière sur Zola et Baudelaire ; la plupart ne l’auraient pas suivi quand il affirmait l’impérieux devoir de réserve des intellectuels en matière politique… Mais, au moins, osons le soupçon : la critique du « pédagogisme » n’a attendu, pour se faire entendre bruyamment, ni Mai 68, ni la loi d’orientation sur l’école de 1989, ni la méthode globale, ni les difficultés d’intégration des jeunes issus de l’immigration. La critique du « pédagogisme » est consubstantielle à la pédagogie elle-même… Et il y a là, tout à la fois, matière à être rassuré et à s’inquiéter. On peut être rassuré face aux attaques de ceux et celles qui accusent la pédagogie d’être un avatar de la post-modernité individualiste, un ersatz de la société de consommation, totémisant le caprice de l’enfant pour camoufler une véritable démission éducative. Ferdinand Buisson, Émile Durkheim ou Gabriel Compayré, les titulaires de la chaire de pédagogie de la Sorbonne, n’avaient pas fait Mai 68… et, pourtant, ils essuyaient les mêmes reproches qu’aujourd’hui ! Mais on peut aussi s’inquiéter : la pédagogie, indépendamment de ses avatars historiques, ne comporterait-elle pas une sorte de « péché originel » ? N’est-elle pas, dans sa posture même, porteuse de dangers qui suscitent légitimement la méfiance, voire le rejet ? Ne fait-elle pas toujours entendre, depuis Rousseau, une sorte de plainte larmoyante qui, au nom de l’intérêt de l’enfant, l’empêche, en réalité, de se développer ? Ne déploie-t-elle pas un arsenal méthodologique sophistiqué pour contourner l’impératif éducatif fondateur : l’injonction à grandir, à s’exhausser au-dessus de l’infantile et du pathologique, à se prendre en charge pour entrer dans le futur ? La pédagogie n’est-elle pas consubstantiellement menacée par la dérive compassionnelle qui s’apitoie sur les malheurs de l’enfant singulier au lieu de l’aider à s’en dégager pour accéder à l’universel ? La question est trop rémanente pour ne pas mériter d’être posée. Et l’on ne peut se défausser devant elle en invoquant la médiocrité de ses formulations et l’inculture de ceux qui la profèrent. Il faut tenter de comprendre ce qui se joue là… et, aussi, tenter d’y répondre. C’est, à la fois, un devoir - fuir le débat serait une lâcheté – et un droit : le droit de réponse, le droit de participer à la réflexion collective, le droit de faire valoir l’expérience de ceux qui, au quotidien, tentent de prendre la pédagogie au sérieux. L’immense mérite du livre de Sylvain Grandserre est, précisément, d’user de ce droit. Mais il ne le fait pas dans un nouveau pamphlet, il le fait en proposant un ensemble de lettres. Et ce n’est pas seulement, ici, un procédé littéraire astucieux. C’est bien plus que cela. C’est une manière, d’abord, de prendre au sérieux l’interlocution de l’autre : on l’entend et l’on tente de le comprendre. On ne renonce pas à ce que l’on croit, mais on accepte de le mettre à l’épreuve d’autrui. On renonce, en revanche, à développer des argumentaires formels, de belles mécaniques rhétoriques, capables de séduire in abstracto tout interlocuteur potentiel. Certes, on ne s’interdit pas – nul discours, en réalité, ne se l’interdit – quelques effets, voire quelques roublardises, mais on les livre au lecteur sans malveillance et, surtout, sans anesthésier ses possibilités de réaction, sans cette intimidation théorique d’une parole qui se dévide dans l’éternité et paralyse l’interlocuteur. La lettre est une adresse et, à cet égard, elle invite à la réponse ; elle propose de continuer le dialogue ; elle ne prétend nullement mettre un point final au débat, bien au contraire. Et puis, la lettre, ici, permet de parler au plus près du quotidien. Non qu’il faille cultiver à tout prix l’empirisme et faire du « terrain » le lieu mythique d’où émanerait spontanément la vérité… Mais, parce que l’éducation, comme la médecine ou la politique, est affaire de pratiques. Les théories et les modèles abstraits sont, certes, des outils précieux, mais des outils qu’il faut mettre à l’épreuve de la temporalité. Plus encore : tant qu’on en reste aux débats spéculatifs sur l’autorité ou l’intérêt de l’enfant, on s’enferme dans des paradoxes insurmontables : faut-il contraindre l’enfant à apprendre, au risque de cultiver chez lui la dissimulation et de renoncer à le former l’autonomie, ou bien lui en laisser la liberté, au risque d’abdiquer sur l’exigence et de conforter les inégalités ? Faut-il faire classe à partir de « ce qui intéresse l’enfant », au risque de laisser de côté des pans entiers de la culture nécessaire à son émancipation, ou bien travailler en fonction de « ce qui est dans son intérêt », au risque de provoquer, chez lui, du rejet, voire de la violence ? Et nous sommes ainsi prisonniers de débats où les arguments s’échangent sans fin… et sans pouvoir convaincre personne. Débats passionnants et passionnés, mais qui font l’impasse sur l’essentiel : éduquer, c’est accompagner, c’est pactiser avec le temps, se dégager de l’impatience du « ou bien… ou bien… », construire des ponts, inventer des situations qui permettent de passer d’un état à un autre, imaginer des médiations concrètes pour des êtres concrets. C’est de cela, justement, dont il est question dans ce livre. Enfin, ces lettres témoignent d’une attitude qui est, sans doute, la seule qui puisse nous aider à avancer démocratiquement vers une éducation plus démocratique, vers un projet éducatif plus authentiquement universel. Notre époque, en effet, a un problème avec l’universel : quand le XIXème siècle campait dans l’arrogance colonialiste d’un « civilisation supérieure », la modernité hésite, elle, entre l’esthétique de la désespérance – « Tout fout le camp… mettons en scène notre malheur ! » - le relativisme – « Tout se vaut… Inutile de rechercher les moindres critères de valeur et de qualité » - et la nostalgie revancharde – « Contre la démission de l’Occident, retrouvons la ferveur de jadis ! »… Il serait bien prétentieux d’affirmer que la pédagogie a trouvé la solution, mais, depuis longtemps, elle a exploré un chemin possible que Sylvain Grandserre parcourt et prolonge ici. Pas de naïveté pourtant : le pédagogue ne sait pas plus que les autres ce qui restera des œuvres d’aujourd’hui : il ignore ce qui, dans le rap, pourra traverser l’épreuve du temps et parler aux hommes et femmes de demain comme Mozart nous parle encore aujourd’hui. S’il ne méprise pas a priori les mangas, c’est qu’il a la modestie de penser que sa culture et ses goûts ne peuvent légiférer sur le futur : il sait bien qu’au XIXème siècle, les intellectuels adulaient Sully Prud’homme – académicien, prix Nobel de littérature - et ignoraient Baudelaire… Mais le pédagogue ne renonce pas, pour autant, à l’horizon d’un universel où pourraient s’accorder les humains. Seulement, il pense qu’il n’est pas donné, que ce n’est pas la propriété de quelques élus. Qu’il ne se transmet pas, comme dans une église, de manière sacramentelle, en imposant les mains et en fermant les yeux. Le pédagogue croit qu’on ne soumet pas les hommes à l’universel, mais qu’on le leur soumet. Que le véritable universel n’est pas ce qui s’impose, mais ce qui s’expose. C’est peut-être pour cela que les professionnels de l’universel a priori lui en veulent tant. Il faut donc lire Sylvain Grandserre et réfléchir avec lui. Parce qu’il invite au dialogue, parce qu’il parle de l’éducation en actes et parce qu’il fait de la vraie pédagogie et non de la théologie. Il force le respect. Parce que c’est un jeune « maître d’école » qui fait souffler sur les débats d’aujourd’hui un vent nouveau. Parce qu’il prend au sérieux la maxime d’un des plus grands pédagogues de la modernité, Fernand Oury : « Ne rien dire que nous n’ayons fait. » Mais aussi, parce qu’il maîtrise, sans en faire étalage, une très grande culture. Et, enfin, parce qu’il fait circuler de la parole entre les différents acteurs de l’École. Rien de spectaculaire, mais l’essentiel : déverrouiller les blocages, faire tomber les barrières, apaiser les peurs, engager au travail collectif. Rien de moins qu’une révolution. La révolution dont nous avons besoin aujourd’hui. Philippe Meirieu Lire la présentation-recension du livre par Pierre Frackowiak |