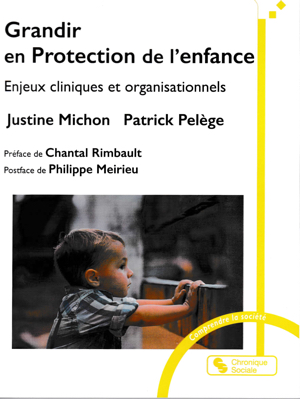|
Postface Conjurer notre malfaisance
Pour un lecteur comme moi, attaché plus que tout aux Droits de l’Enfant mais qui connaît mal la Protection de l’Enfance, la lecture du livre de Justine Michon et Patrick Pelège a été, tout à la fois, une source d’apports précieux, une véritable épreuve – au meilleur sens du mot – et une formidable occasion de réflexion. Autant dire que cet ouvrage ne m’a pas laissé indifférent et que, sur ce sujet, c’est évidemment le plus beau compliment qu’on puisse lui faire. Cet ouvrage est une source d’apports précieux, d’abord. Justine Michon et Patrick Pelège nous donnent, en effet, à lire l’histoire et l’actualité de la Protection de l’Enfance dans notre pays. Une histoire complexe mais dont les différentes étapes éclairent les problématiques actuelles. Parce que ce qui n’est pas logique est, bien souvent, chronologique, il est essentiel de comprendre à quelles questions les différentes réformes qui se sont succédé ont prétendu répondre et comment elles se sont articulées entre elles. On échappe ainsi aux visions manichéennes et l’on donne aux acteurs les moyens de se dégager du dilemme mortifère entre l’adhésion aveugle à l’institution et sa condamnation brutale. On leur permet ainsi de retrouver du pouvoir d’agir, en conscience, tout à la fois, des résistances inévitables et des perspectives d’évolution nécessaires… Or, ces perspectives sont particulièrement bien tracées ici : il s’agit d’ajuster au mieux les dispositifs organisationnels et les comportements des personnes aux besoins fondamentaux de chaque enfant « confié et accueilli » – et pas simplement « placé » ! – dans un environnement sécure où il trouvera l’attachement nécessaire pour se déployer et « grandir en humanité ». Les dispositifs organisationnels doivent, nous expliquent les auteurs, être « écosystémiques », avec un cadre de référence commun et des relations partenariales heuristiques. Quant aux comportements des personnes, analysent-ils, ils doivent obéir à une exigence éthique fondatrice qui associe la reconnaissance de l’enfant dans son histoire singulière, le « pari d’apprivoisement », en dépit des résistances inévitables, et l’acceptation d’avancer dans une « insoutenable légèreté » pédagogique, sans la moindre certitude de réussite ni, évidemment, la moindre quête de réciprocité. « Métier impossible » s’il en est, mais métier essentiel dont dépendent l’avenir de ces enfants et le nôtre. Métier qu’il faut absolument revaloriser, tant matériellement que symboliquement, si l’on veut y attirer les nouvelles générations. Métier qu’il faut libérer aussi de l’emprise technocratique qui l’étouffe parfois au point de phagocyter sa dimension proprement humaine… Car, il ne s’agit rien de moins, nous expliquent les auteurs, que de permettre à des enfants de retrouver une parentalité authentique dont ils ont été privés. En effet – et c’est là un des enjeux majeurs dévoilés par ce livre – , il n’est plus possible aujourd’hui de considérer les capacités requises à l’exercice de la parentalité comme innées ou spontanées. Force est de constater que leur absence est à l’origine de bien des dégâts et que cela assigne à la Protection de l’Enfance deux tâches essentielles et complémentaires : d’une part, proposer aux enfants en souffrance des cadres d’accueil, à la fois sécures et riches en stimulations éducatives, et d’autre part, se donner des objectifs ambitieux en matière de prévention pour faire du soutien à la parentalité une vraie priorité politique. À cet égard, je ne peux que souhaiter ardemment que Justine Michon et Patrick Pelège soient lus et entendus, tant par les praticiens que par les décideurs, par les formateurs que par les politiques. Mais je ne veux pas cacher que la lecture de ce livre a été pour moi, et sera sans doute pour tout lecteur, une véritable épreuve. Car leur texte nous met face à ce que nous voulons trop souvent ignorer : le sort que des humains réservent à certains de leurs enfants, ici, tout à côté de nous, presque sous nos yeux. Nous savons bien en effet – même si nous nous y habituons trop vite – que des dizaines de milliers d’enfants meurent chaque jour sur la planète d’un décès qui aurait pu être évité, que des millions d’enfants vivent dans la rue et n’ont accès à aucune forme de scolarisation, que la violence des guerres, l’injustice des situations, la brutalité des expulsions les frappent durement, et même qu’il existe encore, ici et là, des enfants-esclaves et des enfants-soldats… mais tout cela est loin, après tout, et nous pouvons toujours tenter de nous dire que n’en sommes pas responsables ! Les enfants dont nous parle ce livre, en revanche, sont les nôtres. Ils vivent dans notre pays, fréquentent nos écoles, jouent, aux côtés de nos propres enfants, dans nos jardins publics, et, devenus adolescents, errent dans nos centres commerciaux, nos cités de banlieue ou nos campagnes abandonnées. Ce sont des enfants que nos conventions internationales et nos textes législatifs et réglementaires s’engagent à « protéger »… et que nous voyons ici, malmenés, violentés, abîmés – parfois même détruits – par des adultes censés les élever. C’est peu dire que cette réalité est insupportable et, à proprement parler, impensable. Comment penser, en effet, cette « banalité du mal » qui s’en prend à des êtres qui n’ont pas demandé à venir au monde, infiniment fragiles et totalement démunis, incapables de se défendre et même, simplement, de comprendre ce qui leur arrive ? Comment imaginer qu’on puisse les brutaliser et les violenter, ignorer leur douleur, mépriser leur souffrance, les abandonner à leur détresse ou à leur colère ? Mais il faut refuser de l’imaginer, précisément. Car c’est dans cette acceptation, à proprement parler, que l’inhumain se terre, prêt à fondre sur nous si nous lui en laissons la moindre chance. Or, nous explique Daniel Hameline, « une vertu fondamentale de l’éducateur, s’il lui faut se concevoir vertueux, c’est bien l’indignation. […] Il est impossible d’éduquer sans croire, sans espérer, c’est-à-dire sans s’indigner de l’état dans lequel se trouve aujourd’hui le bien le plus précieux de l’humanité, son enfance, vouée aux nuisances de toutes sortes, à la stupidité, à l’incurie de l’espèce malfaisante que nous sommes. » [1] Et, rien n’est plus précieux que cette indignation. Car, elle seule nous sauve de l’habitude et de l’indifférence. Elle seule nous préserve des justifications statistiques et géopolitiques de celles et ceux qui répètent en chœur qu’« on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Elle seule nous fait ouvrir les yeux sur l’urgence absolue de l’enfant blessé par la vie et le monde. Un enfant dont rien – absolument rien – ne peut jamais justifier l’abandon. Il faut donc saluer le travail Justine Michon et Patrick Pelège pour leur engagement précieux et sans faille pour l’enfance. D’autant plus remarquable qu’il s’effectue mezza voce, évite la grandiloquence inutile, mais ne lâche rien sur l’essentiel. Il faut le saluer d’autant plus que, sans en avoir l’air et avec la distance qui sied à l’interrogation pudique de qui se sait embarqué, comme tout un chacun, dans « l’humaine condition », ils nous font toucher du doigt le mystère de notre malfaisance à l’égard de notre progéniture. J’ai bien écrit « notre » et cela vaut pour notre progéniture mais aussi pour notre malfaisance… Car ce serait trop facile, pour les bonnes âmes que nous sommes – nous qui avons pris la peine de lire ce livre ! – de nous considérer comme totalement et définitivement exemptés de la tentation ou de la facilité de la malfaisance. Car, en matière d’éducation, tout peut basculer très vite et même, parfois, à notre insu. Il y a là colère qu’on ne contient pas et la remarque cinglante qui nous échappe. Le geste qu’on retient mais qui ne trompe pas. Il y a l’absence impardonnable au moment où l’on avait tant besoin de nous. Il y a ces occasions minuscules dans lesquelles l’enfant investit toute son attention et que nous n’avons pas saisies, trop – et toujours légitimement – occupé par nos activités d’adulte… Ce n’est, certes pas, de la maltraitance au sens que nos textes juridiques donnent à ce mot… simplement, peut-être, une maladresse blessante, une petite chose minable aux yeux des êtres raisonnables que nous sommes mais qui peut s’avérer dramatique pour un être fragile dont la conscience nous est – et nous restera toujours – d’une opacité incontournable. Pas question ici, pourtant, de culpabiliser ou de paralyser les éducateurs. Pas question, non plus, de rejeter toute forme de limite ou de contrainte. Notre devoir reste bien d’oser interdire ce qui empêche de penser et de grandir, de formuler, clairement et le plus sereinement possible, les interdits qui autorisent… à vivre en bonne santé, à éviter de se mettre inutilement en danger, à faire en sorte que le monde soit habitable pour soi mais aussi pour les autres, et à engager avec ses semblables des échanges sans violence. L’inter-dit (« ce qui se dit entre des humains ») structure nos relations pour autant qu’il n’est ni arbitraire ni destructeur de notre humanité. Mais l’enfant, comme l’adolescent, est un sujet en construction et nous ignorons très largement ce qui se passe en lui comme les conséquences que peuvent avoir, pour lui, les actes que nous posons ou qui nous échappent. Ce n’est évidemment pas une raison pour refuser de l’éduquer, mais c’est suffisant pour nous imposer une vigilance dont il reste évidemment à définir les contours. Or c’est bien sur la nature particulière de cette vigilance que les auteurs de ce livre nous invitent à penser. Et ils le font efficacement à partir de situations qui, quoique infiniment trop nombreuses, apparaissent souvent au « grand public » comme « marginales ». Ils confirment ainsi qu’en matière éducative, comme dans beaucoup d’autres domaines et selon la formule de Jean-Luc Godard, « c’est la marge qui tient la page ». La marge, ici, ce sont ces enfants malmenés et maltraités, au comportement souvent insupportable, mais qu’il nous faut pourtant tenter inlassablement d’éduquer. Et c’est grâce au défi de cette éducation « spécialisée », par une sorte d’effet-loupe, que nous pouvons réfléchir, plus largement, à ce qu’est un enfant et à ce que requiert cette entreprise essentielle, au cœur de notre condition humaine, qui assure tant bien que mal le lien entre les générations. Pour avancer sur cette question, il faut peut-être revenir à l’œuvre pédagogique et littéraire de Janusz Korczak, tant il est vrai que le pédagogue polonais, qui accompagna en 1942 les enfants de son orphelinat jusqu’aux chambres à gaz de Treblinka, est probablement l’un de ceux qui ont le mieux saisi la contradiction qui est au cœur de la conception contemporaine de l’enfance. Ce n’est pas un hasard, en effet, s’il fut le premier à rédiger une déclaration des droits de l’enfant et si celle-ci est largement à l’origine de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant adoptée en 1989 par la quasi-totalité des États du monde [2]. On se souvient peut-être des polémiques soulevées par cette Convention : celle-ci, en effet, à côté des droits-créances (droit à la santé, au logement, à l’instruction, à ne pas être exploité, etc.), reconnaît à l’enfant des droits-libertés : liberté de pensée, d’opinion et d’expression et « droit d’être entendu sur toutes les affaires le concernant ». Certains, comme Alain Finkielkraut, n’ont pas, alors, manqué de souligner que l’on tentait ainsi la conciliation impossible de deux exigences contradictoires [3] : d’un côté, la nécessité de protéger l’enfant pour tenir compte de sa fragilité particulière et, de l’autre côté, sa reconnaissance a priori comme sujet capable de penser par lui-même… ce que, précisément, il n’est pas encore. Or, c’est précisément en acceptant cette contradiction qu’on peut entrer dans l’intelligence de l’entreprise éducative. L’exercice est difficile tant nous sommes formatés au « ou bien… ou bien… » : un sujet est ou bien un enfant, ou bien un adulte. Ou bien il faut le considérer comme un être assujetti et irresponsable, ou bien il doit être reconnu comme un citoyen à part entière capable de rendre des comptes sur tout ce qu’il fait. Ou bien il est fragile et doit être protégé, ou bien il est lucide et doit être entendu… On peut comprendre que le Code civil et l’approche juridique aient besoin de frontières claires et celles-ci sont évidemment légitimes dans leur domaine. Mais, en matière éducative, les choses ne sont pas aussi simples : un enfant est un sujet en construction ; à ce titre, il est, à la fois, un être inachevé et un être complet. Parce qu’il est inachevé, il a besoin qu’on lui transmette les savoirs et les valeurs qui lui permettront de grandir ; parce qu’il est déjà un être à part entière, qu’il a des émotions et des désirs, qu’il vit des situations complexes et est habité, comme « les grands », par toute une palette de sentiments, il doit pouvoir être entendu, pas seulement dans ses formations réactionnelles mais dans la parole qu’on lui permettra de conquérir progressivement… Comme le montrent bien les exemples et les propositions de Justine Michon et de Patrick Pelège, en Protection de l’Enfance comme dans toute situation éducative, il faut sortir du « ou bien… ou bien… ». Il faut, tout à la fois, protéger l’enfant le plus efficacement possible de tout ce qui le menace ou le détruit et le faire accéder à une parole réfléchie, entendue par les adultes et grâce à laquelle il pourra prendre part à sa propre histoire, s’émanciper en assumant sa contingence et en devenant capable de la dépasser. Car, en réalité, il est impossible de protéger authentiquement un enfant sans entendre ce qu’il a à nous dire, au risque, sinon, de basculer dans un délire de toute-puissance qui décide du « bien de l’autre » sans jamais le reconnaître dans son irréductible altérité. Comme il est impossible d’entendre vraiment un enfant sans le protéger de tout ce qui l’abîme pour lui donner le courage d’oser sa propre parole. Protéger sans entendre, c’est s’exposer au rejet. Entendre sans protéger, c’est se contenter du cri. C’est pourquoi entre une autorité autiste et une compassion désarmée, l’éducateur n’a pas à choisir. Il est délibérément ailleurs, une sorte de tuteur à l’écoute, de protecteur attentif ou, mieux encore, d’allié exigeant… Mais ces formulations ne sont encore que des approximations, des « prises » parmi bien d’autres pour penser et agir l’éducation des plus accidentés de nos enfants, de ceux dont nous confions l’avenir à une « protection de l’enfance » dont on aimerait qu’elle tire toutes les leçons du livre de Justine Michon et Patrick Pelège. _________________________________________________________________________________________________ 1] Daniel Hameline, Courants et contre-courants dans la pédagogie contemporaine, Paris, ESF éditeur, 2003.
Philippe Meirieu
|