|
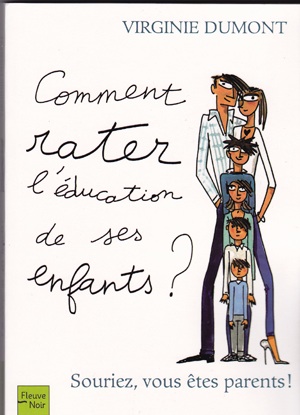 « Ne tirez pas sur le pianiste… « Ne tirez pas sur le pianiste…
Changeons la partition de l’orchestre ! »
Au Café du Commerce comme sur les ondes de France Culture, chacun pérore sur la difficulté d’élever nos enfants aujourd’hui et dénonce le vaste complot à l’origine de tous nos malheurs : un groupuscule de pédagogue irresponsables, soixante-huitards forcément « attardés », aurait pris le pouvoir en France depuis quarante ans et installé une idéologie de « l’enfant roi » qui ruine définitivement l’autorité des adultes en famille comme à l’école, abolit toute exigence intellectuelle, sape le niveau en orthographe, encourage les jeunes à basculer dans la violence aveugle et compromet définitivement la place de la France dans le monde !
On pourrait en rire, bien sûr, tant le procédé est caricatural et le mensonge grossier : les pédagogues n’ont cessé, en effet, de rappeler l’importance de la « construction de la loi » et de souligner la nécessité de l’implication de l’enfant dans des « activités » capables de lui faire découvrir l’importance des normes et les exigences du travail individuel et collectif. Ils n’ont cessé de dénoncer les impasses du spontanéisme et de montrer qu’il n’était que le corollaire de l’autoritarisme : on trépigne et s’épuise dans le « Fais comme je veux ! »… avant de s’avachir dans le « Fais comme tu veux ! » : « Après tout, puisque tu ne veux rien entendre, tu n’as qu’à en faire qu’à ta tête ! Moi, ma vie, elle est faite ! Tant pis pour toi ! ». Ainsi, la toute-puissance de celui qui confond l’éducation avec une fabrication et l’impuissance de celui qui prétend « respecter » une liberté qu’il faut précisément aider à émerger, ne sont que les deux faces de la même incapacité à penser la spécificité de l’entreprise éducative : créer des situations, penser des systèmes de contraintes et de ressources grâce auxquelles l’enfant, comme le disait le pédagogue fondateur de la modernité pédagogique, Pestalozzi, peut « se faire œuvre de lui-même ».
Mais la technique du bouc émissaire n’est pas seulement le signe d’une formidable inculture pédagogique, elle est aussi un moyen d’éviter de regarder en face les raisons fondamentales qui permettent de comprendre pourquoi il est, effectivement, plus difficile que jamais d’élever ses enfants aujourd’hui. Et ainsi, non seulement on rate une analyse essentielle à l’intelligence de la modernité, mais on s’interdit d’agir de manière pertinente sur des situations complexes. La caricature nous exonère à la fois de faire un peu de théorie et de changer nos pratiques.
Rappelons donc, d’abord, que nous assistons à une formidable accélération de l’histoire. Jusqu’à présent, les générations se superposaient suffisamment pour se transmettre l’essentiel des outils et méthodes éducatives. Les nouveaux parents disposaient donc, dans leur sac à dos, de solutions plus ou moins prêtes à l’emploi, héritées de leur propre éducation. Face à une question avec leurs enfants, leur première et légitime réaction était de se demander : « Qu’auraient fait mes parents à ma place ? », ou, plus simplement encore : « Qu’ont-ils fait avec moi quand je leur ai posé un tel problème ? ». Mais ils ne trouvent pas de réponse toute prête dans leur sac à dos quand ils se demandent aujourd’hui : « À quel âge faut-il acheter un téléphone portable ? » Ou : « Que faire face à mon fils qui passe cinq heures par nuit devant You Tube et Second life ? » Ou encore : « Comment réagir quand ma fille pratique la scarification ? » Et qui, franchement, peut prétendre avoir une réponse satisfaisante à ces questions ? Ces questions sont radicalement nouvelles. Les réponses éducatives sont à construire, pour chacun et par tous. Elles ne tomberont pas du ciel !
Car voilà bien une donnée fondamentale de la modernité : aucun « ciel éducatif » ne dicte plus sa loi. Aucun catéchisme, dans nos démocraties occidentales, n’a légitimité à imposer des principes et des règles capables de régir l’éducation de manière « évidente » et indiscutable. La chute des théocraties religieuses – le christianisme – ou laïques – le grand récit marxiste – nous laisse orphelins : sans vision claire d’un avenir commun, nous ne savons plus « à quoi éduquer nos enfants ». Nous avons, tant bien que mal, construit un cadre démocratique pour se substituer à l’oppression d’une verticalité imposée, mais notre démocratie n’est pas aujourd’hui capable de définir un « bien commun éducatif » qui vectoriserait et unifierait nos interventions éducatives, en famille, à l’école et dans la société… Pas question, pour autant, de revenir en arrière. D’abord, nous n’en voudrions pas, ni pour nous ni pour nos enfants : qui, sérieusement souhaite revenir au temps de la famille bourgeoise de jadis et de la « pédagogie noire » des années 1920 ? Nous préférons encore, et à juste titre, les excès de nos lascars aux « désarrois de l’élève Törless » ou aux persécutions malsaines de Ruban blanc… De plus, nous craignons – et nous avons infiniment raison ! – la montée de nouvelles théocraties fondamentalistes avec leur cortège d’oppressions et d’assujettissements. C’est pourquoi la faillite des théocraties traditionnelles en Occident, souvent présentée comme une « crise », est aussi une chance pour fonder l’éducation sur le travail collectif d’une société adulte, capable de se projeter dans un futur et de se doter d’un vrai projet éducatif par et pour la démocratie. Mais il faut, pour cela, que nous sortions de nos individualismes !
Or, justement, rien n’est gagné de ce côté-là ! « L’individualisme social » est, en effet, aujourd’hui triomphant. Dès lors que rien ne vient du dessus « faire tenir les hommes ensemble » et que le travail démocratique ne prend pas vraiment le relais, chacune et chacun se pense fondé à considérer ses intérêts individuels comme pouvant avoir force de loi. La société devient une juxtaposition d’individus plus ou moins rassemblés dans des groupes fusionnels identitaires inféodés à quelques leaders charismatiques. On cherche en vain, dans le champ politique, des configurations de sujets débattant raisonnablement sur des objets identifiés. Seules des initiatives associatives ou quelques expériences de « démocratie participative » tentent de briser la loi de l’individualisme social et de construire des agoras pacifiées au milieu de l’exaspération des rapports de force. Chacune et chacun se dote donc de ses propres repères, avec pour critère ultime de validité le fait d’ « être bien dans ses baskets ». Difficile de construire une éducation émancipatrice pour notre temps dans ces conditions !
D’autant plus que nous oublions trop vite une des caractéristiques majeures de notre temps : pour la première fois, avec le recul de la mortalité infantile et la systématisation heureuse de la contraception, tout enfant qui vient au monde est un enfant désiré. Ne nous en plaignons pas ! Mais constatons le glissement, trop souvent ignoré, entre « enfant désiré et « enfant du désir » : quand l’enfant devient l’ « enfant du désir », il est là pour combler le besoin des adultes. Ce n’est plus aux parents de faire le bonheur de l’enfant, mais à l’enfant de faire le bonheur des parents. Ce n’est plus la famille qui fait les enfants, mais l’enfant qui font la famille. Et chaque adulte veut être aimé, le plus aimé, par un enfant à qui l’on confère ainsi prématurément un pouvoir fantastique. Là se trouve, sans doute, un nœud essentiel : aucune véritable éducation n’est possible quand les adultes se livrent à une surenchère pour obtenir l’amour, quand ce n’est pas l’assentiment, de leur progéniture !
Faut-il, alors, renoncer à éduquer nos enfants ou se contenter de livrer, au jour le jour, une éducation empirique guidée par les circonstances et calée sur les conseils qui nous arrivent de tous côtés, orchestrés par les psys de toutes sortes et les commerçants réunis ? Sans aucun doute, non. Ce serait suicidaire ! Il nous faut, en revanche, simultanément, penser ensemble les conditions à moyen et long terme d’une éducation à la démocratie, et se doter d’une morale provisoire. Une éducation pour la démocratie, c’est une éducation qui fait de l’apprentissage de la pensée autonome son objectif premier : restaurer le sursis à l’acte contre le triomphe du pulsionnel, donner du temps et des outils pour réfléchir afin d’échapper au caprice mondialisé, permettre l’émergence de configurations délibérantes contre les coagulations fusionnelles et passionnelles… Se doter d’une morale provisoire en attendant : ne pas se laisser manipuler par les slogans ni sombrer dans les facilités du moment, résister à la pression du mimétisme de la mode, du consumérisme des marchands, du passéisme des nostalgiques et de l’aventurisme des apprentis sorciers. Bref, résister à l’air du temps. Faire œuvre d’intelligence. Ou, en d’autres termes, conjuguer l’humour et l’obstination. La distance qui nous libère et l’implication qui nous engage. Vers moins de sottises et plus d’humanité. C’est ce que fait admirablement ici Virginie Dumont. C’est pourquoi il faut la lire toutes affaires cessantes.
Philippe Meirieu
Professeur à l’université LUMIERE-Lyon 2
|
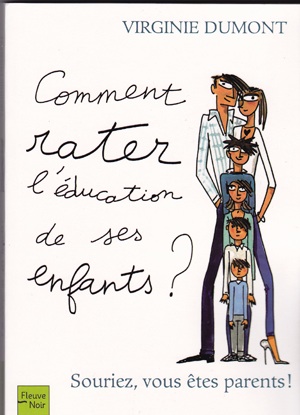 « Ne tirez pas sur le pianiste…
« Ne tirez pas sur le pianiste…